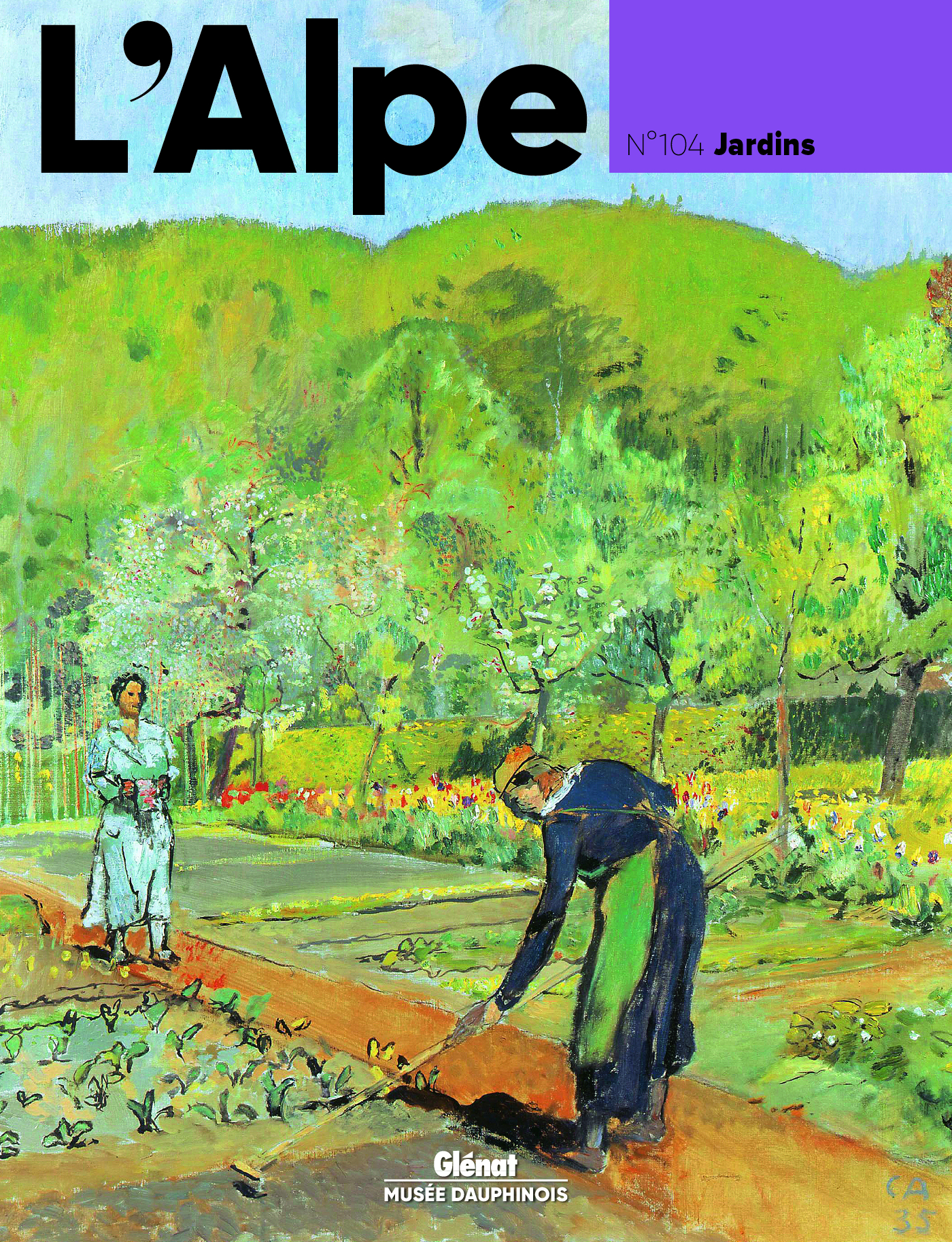La fée des glaces
N’y a-t-il rien de plus fragile et de plus éphémère qu’une soldanelle qui danse à la fonte des neiges, une prière humaine dans une chapelle d’altitude, un concours olympique ? Et pourtant, n’y a-t-il rien de plus fort et de plus éternel aussi ? C’était il y a quarante ans. Après Killy, triple lauréat en ski alpin, il y eut Peggy, l’unique. Elle entre sur la piste. Elle ne regarde pas ce public qui n’a d’yeux et de cœur que pour elle. Elle regarde… l’espace. Elle sourit, de ce sourire indéfinissable venu du plus profond d’elle-même. Un ange passe. Elle cherche ce petit bout de patinoire où elle va commencer. Ses yeux immenses caressent encore l’éternité d’un regard. Nous sommes le 11 février 1968 et, en quatre minutes et neuf secondes, Peggy Fleming va conquérir le monde.
Double championne du monde, elle est favorite. Elle s’est isolée de tout, au milieu de son écrin de montagnes. Deux jours plus tôt, elle a gagné les figures imposées à l’unanimité des neuf juges. Elle aime l’immense patinoire construite spécialement pour les Jeux, avec ses grandes arches ressemblant à des ailes. Ici, dans la pression de l’événement, entre sa mère et son entraîneur, elle n’a « qu’une seule amie » comme elle dit : sa musique, qui va l’abstraire de ses peurs et de son trac, qui va l’élever. Elle l’attend. Tchaïkovski, puis Saint-Saëns. Quand Peggy patine, la musique participe de l’espace. Les millions de téléspectateurs qui la regardent sont conquis, acquis pour toujours. À elle et au patinage. Car Peggy l’offre au monde en partage.
En vérité, elle ne patine pas, ou si peu. Elle caresse l’espace : la glace, de ses carres précises et souples ; l’air, de ses mains de ballerine ; le public, de ses yeux étonnés et tendres. Pour cette compétition, sa mère lui a réalisé une tunique verte, couleur de la liqueur de Chartreuse. Noués en chignon, ses cheveux adoucissent encore son visage. Ses bras montent au ciel. Pirouettes, arabesque, puis l’un des plus beaux enchaînements qui soient : grand aigle, axel, grand aigle dès la réception, petit aigle ; double boucle, double axel, double lutz… Les sauts et la technique appartiennent au sport, mais seule la grâce de la patineuse importe aux millions de spectateurs du monde entier.
« Deux minutes quarante-cinq : encore une minute quinze de joie ! », commente Claude Darget pour la télévision. La pie voleuse de Rossini. Petits pas, pirouette assise. La musique s’emballe, saut écarté, double flip et double boucle piqué en combinaison, pirouette sautée, Peggy s’envole dans sa pirouette finale. On ne la voit plus, elle va si vite ! Et l’émotion chavire, elle se dissout dans l’espace. Puis elle arrête son élan, pose à nouveau son regard sur le monde, ou bien sur elle-même. En cet instant c’est la même chose. Elle salue comme une ballerine, longuement, profondément. Elle a fini. L’apparition redevient humaine.
Peggy reçoit des brassées de fleurs, elle pleure. L’émotion, la sienne, la nôtre, inonde son beau visage. Elle n’est plus seulement la concurrente américaine. Elle est aussi française, italienne, suisse, autrichienne et de tous les pays du monde : elle est universelle. Pour toujours, son nom restera attaché au patinage, celui qu’on aime. Si ce sport est aujourd’hui aussi populaire, si les yeux brillent quand on parle de glisse et de glace, c’est parce qu’un jour, en France, au pied de l’alpe, trois mois avant l’embrasement du mois de mai, une jeune fille est venue dire de ses plus beaux patins l’amour et la paix au monde.
Jean-Christophe Berlot, auteur d’ouvrages sur l’histoire et l’actualité du patinage.