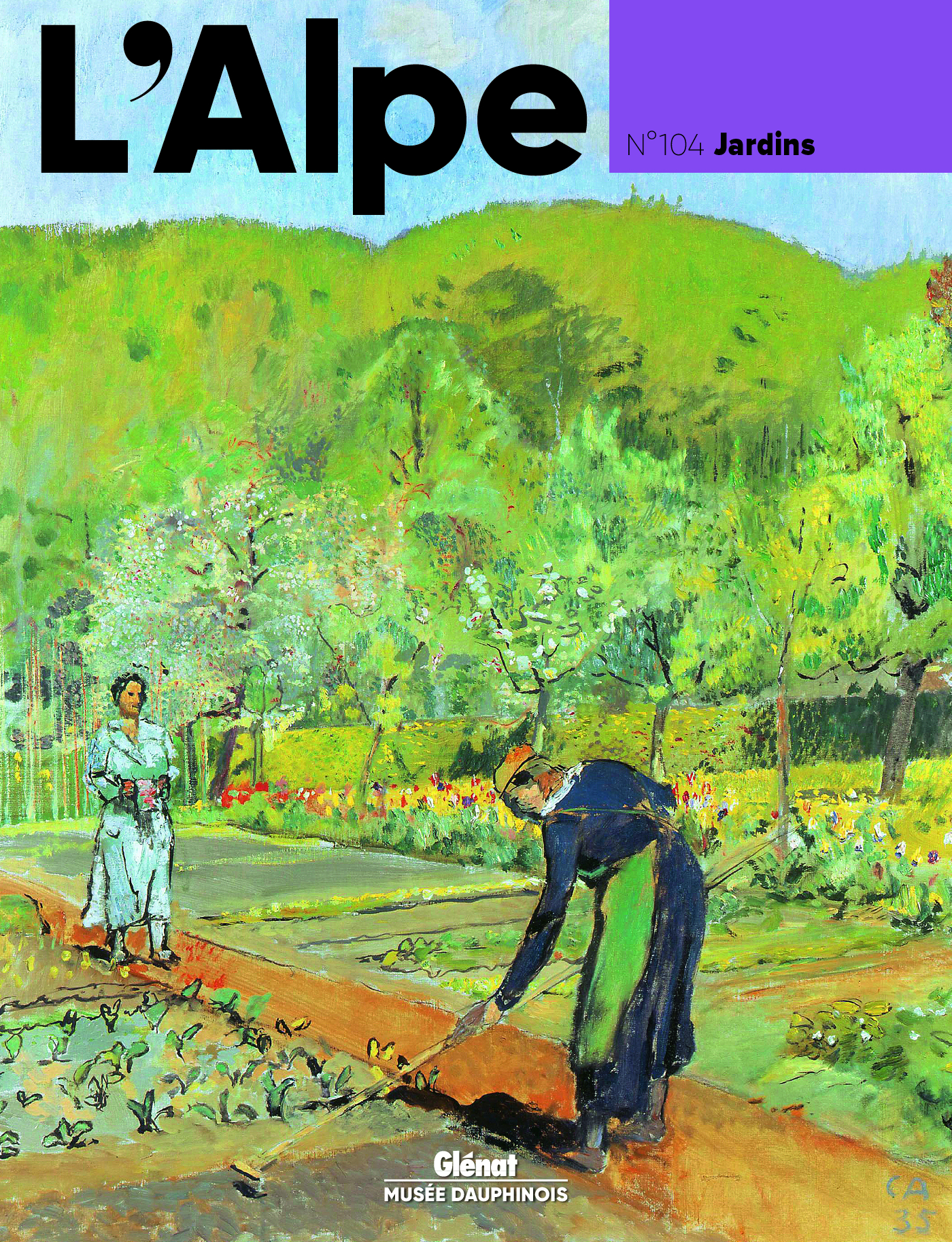Magique, la montagne ?
Parler de rencontre avec les Alpes, avec le monde alpin, peut sembler à la fois prétentieux et dérisoire, mais je ne vois pas comment je pourrais m’exprimer autrement, moi qui ai, hormis quelques brefs voyages, vécu dans une grande ville jusqu’à l’âge de 14 ans. C’est alors que j’ai été « mené » à la montagne et mis en sa présence, sans ménagement ni préparation ! Mon initiation a été plutôt brutale, tant sur le plan physique que psychologique : marches forcées, obligation d’admirer et d’exprimer les beautés sublimes, célébration contrainte des vertus montagnardes.
Loin de moi l’idée de reprocher cette « violence » à ceux qui me l’ont infligée, mais je pense utile de la rappeler car elle a conditionné mon rapport aux Alpes. C’est vrai, je les ressens beaucoup plus comme une initiation douloureuse que comme une découverte agréable et éblouie de régions « extrêmes », à travers la marche, l’escalade et le ski, relations très physiques à l’environnement auxquelles j’ai dû renoncer assez vite pour des raisons de santé.
Jusqu’à l’âge de 20 ans, j’ai pourtant appris à apprécier ces relations, sinon à les aimer. J’ai en revanche détesté l’obligation d’admirer béatement les montagnes, les cimes, les glaciers, les torrents, les alpages et les panoramas, de devoir m’extasier sur toutes ces beautés, et surtout d’entendre des clichés dont la grandiloquence le dispute souvent à la banalité ! Les Alpes valent mieux que cela. J’ai compris assez vite qu’il y avait là un jeu dont je ne maîtrisais ni le langage, ni les médiateurs.
J’aurais probablement eu les mêmes problèmes avec la mer que je ne connaissais pas non plus, moi le petit citadin ignorant de toutes ces beautés et grandeurs de la nature ! La mer et la montagne sont en effet les deux pôles paysagistes qui incitent au lyrisme facile et souvent faux, construit à coups d’images convenues qui traînent dans la littérature. J’éprouvais alors une certaine colère à l’endroit de ceux qui m’assénaient le sublime, la liberté et la valeur de la montagne, tout cela enrobé d’épithètes glanés ici et là. Ainsi, j’ai d’abord franchement détesté les Alpes car je ne les connaissais pas.
Au début de mes études à l’université de Genève, j’ai eu la chance d’être l’élève du professeur Édouard Paréjas, qui m’a initié à la géologie des Alpes. Il commençait son premier cours en disant : « Messieurs (il n’y avait pas alors une seule fille, mais en revanche un certain nombre d’étrangers !), vous avez deux patries, la vôtre et les Alpes ! » On soupçonne derrière cette formule toute une philosophie de la montagne qui imprégnera, beaucoup plus tard, la fameuse Convention alpine, signée en 1991 par les pays de l’arc alpin et l’Union européenne.
Du rejet à la connivence
Paréjas voulait surtout dire que la géologie, dont le Suisse Horace-Bénédict de Saussure fut l’un des premiers représentants, devait énormément à l’observation des Alpes. J’ai alors été fasciné par la complexité de cette géologie alpine et les excursions m’ont fait comprendre la montagne à travers l’observation scientifique. Plus tard, je me suis intéressé à l’histoire des Alpes, aux transports, aux écosystèmes fragiles et à bien d’autres choses. Les premières expériences désagréables, sinon négatives, que je relate brièvement plus haut, m’ont cependant suffisamment marqué pour m’inciter à tenter de comprendre la « réception » des Alpes par les auteurs qui les ont décrites, qui en ont disserté ou tout simplement parlé, après les avoir parcourues ou traversées au cours de l’histoire.
On peut également se pencher sur tout ce qui ressort aux Alpes rêvées ou imaginées, révélatrices des tendances profondes et cachées des sociétés. L’étude d’un thème géographique comprend au moins deux aspects : la représentation de l’objet selon une problématique et un langage spécifiques, et son interprétation. Cela veut dire que la représentation d’un objet géographique quelconque est, en même temps, la mise en scène de l’auteur et le révélateur de sa personnalité.
Dans mon cas particulier, j’userai d’une formule assez classique en disant que « l’ontogenèse a récapitulé la phylogenèse ». Qu’est-ce à dire ? Que mes attitudes et mes comportements, face aux Alpes, passent par les mêmes phases ou stades de rejet, de crainte, d’acceptation et finalement de connivence que l’on a pu l’observer depuis la fin du XVIe siècle.
Car il y a bien un mythe alpin commun à l’Occident, qui commence à s’élaborer à partir du XVIIe siècle, pour s’amplifier au XVIIIe et s’épanouir au XIXe. Jusqu’alors, la montagne inspire l’effroi car elle est l’image du désordre et du chaos auquel l’homme, pour accomplir le plan divin, doit chercher à opposer un système ordonné. Des textes de voyageurs, des anecdotes et des observations rapportées par de multiples auteurs en témoignent éloquemment.
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le mythe alpin, inventé à l’extérieur des Alpes mais auquel adhèrent ses habitants, s’est constitué en contrepoint à la révolution industrielle et à son corollaire l’urbanisation. Publié en 1924, le chef-d’œuvre de l’Allemand Thomas Mann, La montagne magique, apporte une caution littéraire au mythe qui, d’avatar en avatar, s’est transformé, mais a subsisté. Les Alpes sont devenues un bien commun à travers le mythe qui joue un rôle essentiel dans l’imaginaire contemporain.
Des discours qui font sourire
Nombreux sont le documents permettant de suivre cette phylogenèse des Alpes dans la conscience européenne. À commencer par l’autobiographie de Thomas Platter, ce chevrier valaisan du XVIe siècle devenu recteur des écoles de Bâle dont la vie, presque trop exemplaire, est révélatrice de ce vécu alpin. Ou encore l’œuvre de son contemporain, l’historien suisse Josias Simler, auteur d’une sorte d’encyclopédie alpine (De Alpibus commentarius) et qui incarne le regard de l’Autre, celui du voyageur s’abritant derrière l’autorité des textes. Un regard médiatisé par le document, comme cela sera le cas de nombreux auteur jusqu’au XIXe siècle. Les témoignages convergent alors pour dénoncer les dangers, l’inconfort, les souffrances endurées, le caractère peu hospitalier des habitants.
La page est tournée au XVIIIe siècle par un autre Suisse, Albrecht von Haller, et son célèbre poème Les Alpes (1732). Cette idéalisation de la montagne, largement renforcée par La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau (1761), marque le début du mythe alpin auquel sacrifieront toutes les générations jusqu’à nos jours. Après eux, des artistes illustrent la montagne, généralement comme ils pensent qu’il faut la voir plutôt que telle qu’elle est. Les Alpes sont un décor déformé payant tribut au goût du temps. Au XIXe siècle, littérature et science se séparent, les poètes assurant la promotion de la montagne tandis que les naturalistes se chargent de leur découverte à des fins scientifiques. Les peintres, pour leur part, confortent le mythe du paysage alpin.
Le romantisme offre de nombreuses pages sur les Alpes, donnant surtout le goût des légendes, comme celle de Guillaume Tell, symbole de liberté. Bien souvent, la montagne est avant tout un prétexte : elle véhicule un message, qu’il s’agisse de l’influence morale qu’elle exerce sur les âmes ou, à travers les farouches vertus alpines, des notions de démocratie et de solidarité, de générosité et d’hospitalité. Des idées qui seront souvent reprises jusqu’à nos jours.
Ces regards jetés sur les Alpes depuis le XVIIIe siècle ont évidemment contribué à construire leur réalité comme leur mythe et tous ces discours m’ont été administrés dans mon adolescence. J’en ignorais alors l’origine. Aujourd’hui en revanche, quand je me trouve avec des « montagnards » qui m’expliquent la montagne dans les termes des siècles passés, j’ai beaucoup de peine à ne pas sourire car je revis mes premières expériences ! Mais ma colère juvénile est depuis longtemps retombée…
Claude Raffestin, diplômé en géographie, docteur en sciences économiques et professeur de géographie humaine.