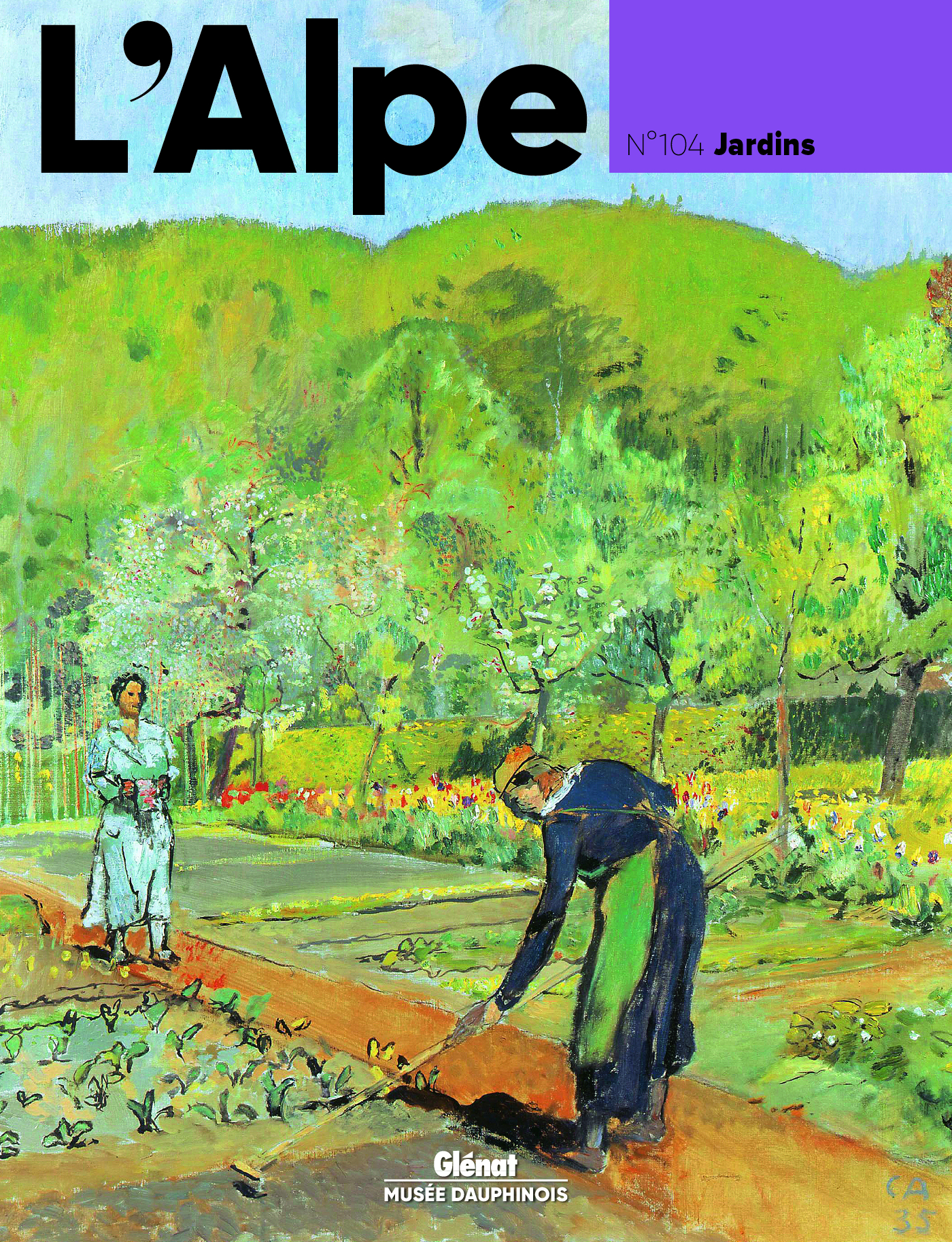Road movie en Helvétie
Autant le dire tout de suite. Je suis né en Valais, au cœur des Alpes, à un jet de pierre de Chamonix. Et j’ai grandi là, à Fully précisément, au pied du Grand Chavalard, montagne emblématique et nourricière qui vient régulièrement vomir pierres et avalanches dans nos jardins. Le vignoble de Fully épouse les formes du mont, tantôt convexe, tantôt concave. C’est un cirque étonnant, tout en terrasses et murs de pierres sèches aux noms évocateurs : Combe d’Enfer, Plamont ou Creux-Devant. On entend les cigales l’été, lorsque se taisent les atomiseurs qui pulvérisent le soufre ou le cuivre sur le feuillage. Elles se cachent dans les chênes pubescents, qui forment par-ci par-là de petits bouquets, à l’ombre desquels nous prenions le goûter, lors des rudes journées d’effeuillage en juin.
Parfois, on entend aussi (il faut être patient et très attentif) les travailleuses de la vigne. Dans les années 1950, des chœurs pouvaient se former, où l’accent valdôtain se mêlait au nôtre, teinté du même patois franco-provençal. Plus tard, on a chanté en italien, en espagnol, en portugais et en serbo-croate. Aujourd’hui, on surprend parfois des complaintes venues d’Afrique, du Cap-Vert ou d’Angola. La plupart du temps, on entend seulement le souffle brûlant qui agite le feuillage et les voitures fonçant avec détermination et empressement sur l’autoroute.
À Fully, le Rhône est encore une modeste rivière aux colères ravageuses. Enfant, on s’amusait à jeter des pierres d’une rive à l’autre et on y arrivait parfois lorsque le vent nous aidait. Jamais on ne s’y baignait ! Grands dieux ! Le courant était si fort qu’il nous aurait portés au Léman en moins de temps qu’il ne faut pour le dire et l’eau glacée nous aurait pulvérisé les os. Le limon déposé par le fleuve est un sable délicat, bien plus souple que celui qu’on rencontre sur les plages de Méditerranée. On le laissait couler entre les doigts comme de la farine. Il est si fin que le vent chaud de l’automne le fait tourbillonner. On dirait alors des colonnes de fumée.
Les terres agricoles ont été gagnées sur le fleuve auquel on a gommé ses variantes. Aujourd’hui, il ne gambade plus à son aise, son parcours est devenu rectiligne, il est enrégimenté entre deux hautes berges qui offrent une sécurité illusoire aux habitants de la plaine. Ces bandes de terres volées au fleuve et aux étangs alentour étaient pour nous plus précieuses que les vastes plaines américaines ! Les anciens étaient si fiers de leur forfait qu’ils ont baptisé les nouveaux lopins de noms exotiques, ceux des terres lointaines où avaient émigré leurs aïeux. Mon père étant agriculteur, j’ai ainsi passé mes étés dans sa Petite Californie. J’ai ramassé des pommes au Brésil, planté des tomates en Argentine.
D’autres toponymes rappellent le combat contre le fleuve (les Barrières, les Grands Barres) et les conflits pour se partager son butin (le canal du Syndicat, les Petites et Grandes Portions, les Sorts). On édifie aujourd’hui villas et pavillons sans âme au Marais Neuf ou au Marais Roulet. Les grenouilles se font toujours entendre. Elles apparaissent comme par miracle aux premières chaleurs et colonisent effrontément le moindre biotope humide. Le paysage est un livre d’histoire.
Un pays confetti
Lorsqu’on vit dans les Alpes Suisses, on se sent façonné et pétri par la montagne. En sa possession. Alors, forcément, on l’adore et on la déteste. Et un jour, on s’enfuit, à pied, à vélo, ou comme je l’ai fait une fois, à moto. Le Valais est idéal pour les fugueurs. Il suffit de rouler quarante kilomètres pour se retrouver à l’étranger : en France, en Italie ou en Suisse allemande. La Suisse allemande, ce n’est pas vraiment l’étranger, c’est plus étrange encore, plus proche et plus éloigné. J’ai donc enfourché Suzie, la vieille moto de mon oncle et pris à travers le Haut-Valais pour un voyage qui devait durer toujours. Mais comment expliquer la Suisse allemande. Comment expliquer qu’il suffit d’enjamber une montagne pour se retrouver dépaysé ? Comment expliquer ce pays confetti, si étrange, austère et mystérieux ? À chaque virage, je répétais : « Comment raconter cela ? » Et vouloir le raconter aiguisait mes sensations. Je songeais à Jean Giono ou à Charles-Ferdinand Ramuz, au Déserteur et à Farinet. Mais ces deux-là ne faisaient pas de moto.
Il faut remonter toute la vallée jusqu’au glacier du Rhône, puis choisir entre deux routes, qui franchissent des cols à plus de 2 000 mètres d’altitude : la première va vers l’Allemagne à travers la Suisse allemande, par le Grimsel qui relie le Valais au canton de Berne, et l’autre en Italie, par celui du Gothard et le Tessin. On a toujours été fier de cela. De pouvoir ainsi lier la Méditerranée à la mer du Nord. Ce jour-là, il neigeote. Des flocons se retrouveront dans le Rhône, d’autres dans le Rhin. Une fois le col du Grimsel passé, la route plonge dans la fournaise. C’est étonnant. En une demi-heure, on passe de l’hiver à l’été, des neiges éternelles aux crèmes glacées des rives du lac de Brienz.
Je pratique le paysage. Les virages me parlent, les arbres me parlent, les fleurs me parlent, les toits des maisons, les cloches des églises… Et ça résonne, ça tinte, ça virevolte ! Je plonge à l’intérieur de moi. La moto est en quelque sorte un sous-marin. Pour me libérer de tout cela, je parle à toute vitesse, pour me vider avant que tout n’explose, avant de devenir aussi gonflé que le bonhomme Michelin. Je parle dans mon casque et je hurle à Suzie, ma moto, mon confessionnal. Tous les motocyclistes font peut-être cela. C’est pour cela qu’ils mettent des casques.
Dans l’Oberland bernois, ce « haut pays », tout est si beau, si propre, si bien rangé. En voyant un gosse dans un jardin potager, un deuxième suspendu au sein de sa mère et un troisième accroché à la jupe d’une grand-mère, je me suis surpris à penser : « Pauvres petits, vivre dans un tel paradis, où le bonheur suinte par toutes les portes, où le fumier sent bon. Ce doit être l’horreur ! Pauvres enfants, condamnés à vivre là au milieu de tant de bonté. » Et je disais à Suzie : « Allez, lâche deux ou trois pétarades bien fumantes, bien graisseuses, qu’ils voient à quoi ressemble la vie ! »
Quand la ligne droite courbe l’échine
Giessbach, sur le lac de Brienz, est un village exemplaire comme on n’en fait plus, même dans les livres pour enfants. Il faut stationner à cent mètres de la première maison pour ne pas déranger les senteurs des azalées et des roses trémières. Là, je me suis trompé de route et me suis retrouvé au centre de la rue piétonne. Ma présence à moto était de la provocation. C’est là que Suzie perd son pot d’échappement et se met à pétarader comme l’enfer… J’ai traversé le village sous le regard réprobateur des habitants, les huées des touristes et des marchands de glaces. Au sortir du village, d’un simple coup de talon, j’ai remis le pot en place.
J’ai passé la nuit dans la petite ville de Thoune. Je me suis arrêté dans une vinothèque. Au milieu des spécialités italiennes et françaises, un vin blanc de chez moi, une petite arvine de Fully. J’ai commandé une demi-bouteille car j’avais déjà le mal du pays. Et je l’ai bue seul, sur la Mühleplatz, assis à une minuscule terrasse face à un bar où s’abreuvaient de bière les soldats francophones de la place d’armes voisine et les jeunes filles qui les toisaient.
Le matin, j’ai pris conscience avec étonnement qu’ici on ignore la ligne droite. Tout est courbe, vallonné, sinueux. Ce pays rejette la brisure, la cassure et les angles. Ça vallonne, ça monte avec douceur ou ça descend gentiment, ça se tortille. Le paysage étale ses bourrelets avec nonchalance. Tout serpente, les rivières, les routes, les voies de chemin de fer. Alors forcément, avec le temps, même les lignes droites se mettent à courber l’échine.
En Valais, c’est différent. On a une vallée plate et parfaitement rectiligne : cent kilomètres de ligne droite et de chaque côté des montagnes qui se jettent à pic. Les vallées latérales s’ouvrent à l’équerre. Elles sont trouées à la verticale par des torrents furieux. Et le ciel est bien accroché, au-dessus de nos têtes, tendu comme une toile de tente. Dans l’Oberland bernois, au contraire, le ciel est partout, tantôt devant, tantôt dessous ; à se demander si l’on n’y est pas déjà arrivé à son insu !
Des vaches en carton repeintes pour la saison
Ici, les toits des maisons sont immenses. Et il y en a partout. Même sur la croix, au carrefour. Ainsi, le crucifié ne souffre ni du soleil, ni de la pluie. Sur leurs routes, il y a des panneaux qui n’existent que là-bas, « Attention aux toits », pour éviter que les camions ne les accrochent au passage. Il y a aussi des fleurs partout. Ça dégouline. Des bacs entiers de géraniums qui dégueulent des fenêtres. Même les usines sont fleuries. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Dans des bacs en bois. Jamais d’acier, de fer ou de plastique, il leur faut du bois. Sculpté de jolis motifs qui représentent… des fleurs.
Tu sens tout à coup que tu es dans un pays truqué. Que ce pays s’est arrêté pour le photographe… « Pauvres vaches ! » me disais-je, devoir jouer les décors. Alors que les nôtres, celles de la race d’Hérens, luttent au centre de l’arène et se battent à coups de corne pour défendre l’honneur de la famille, celles-ci semblent être en carton mâché. On devine que les taches brunes ou noires, si bien découpées sur fond blanc, bien disposées et arrangées dans le paysage, viennent d’être repeintes pour la saison touristique. Et tu comprends qu’un mécanisme d’horlogerie leur donne l’illusion du mouvement et fait tinter leur sonnaille. Je ne serais pas étonné qu’elles chient du chocolat, il ne peut sortir de la bouse d’un animal en carton mâché.
Dans ce gigantesque Disneyland, on croise des hommes à deux roues qui se répartissent entre cyclotouristes masochistes et cyclistes publicistes. Ici les routes montent aussi souvent qu’elles descendent. Les masochistes, qui pourraient se promener dans le plat pays ou aux Pays-Bas, viennent justement traîner ici leurs lourdes bicyclettes chargées comme des mulets. Et ils s’en vont gravir les cols, cahin-caha. Dans les descentes, ils sont tellement lourds qu’ils freinent à mort de peur de chuter. Ah, que j’aimerais fixer sur Suzie un canon à purin et asperger ces empesteurs de paysage, ces ennemis du progrès qui ignorent le moteur à explosion et le remonte-pente !
Quant aux publicistes, avec leurs vélos racés comme ceux du Tour de France, ils arborent sur le dos leurs marques préférées. Encore de la pub ! Et gratuitement en plus ! Je crois que je vais installer un bazooka sur la petite Suzie pour faire sauter un de ces hommes sandwichs montée sur boyaux et deux ou trois de ces fermes fleuries. Tant de joliesse, tant de gentillesse, tant d’efforts inutiles ; ça me rend méchant !
Avec la niche, le chien, le cerisier et l’épicier
Alors que ces idées mauvaises me venaient au casque, je décidai, plutôt que de me morfondre sur la grande route, de quitter les voies goudronnées pour m’enfiler dans les chemins vicinaux. Je vis au loin la silhouette d’un vieil homme de sombre vêtu, accompagné de deux magnifiques chiens. Des bouviers bernois, cela va de soi. Arrivé à sa hauteur, j’étais convaincu que la marche et la moto étaient les seuls moyens de locomotion dignes de l’être humain, avec le cheval bien sûr. Mais voilà que les bouviers se mettent en tête de me déchiqueter. À moins qu’ils ne veuillent bavarder ?
Dans le doute, j’ai vite pris la direction des cols du Pillon puis de la Croix, bien décidé à laisser là cartes postales et molosses. Je me suis alors offert une plongée sur le canton de Vaud. Plongée est bien le mot tant la route semble chuter. J’ai dû auparavant affronter l’ultime infamie, sous la forme d’une caravane tractée par une voiture belge. Une caravane, c’est une façon de dire « je pars » sans partir. Ou plutôt : « J’emporte mon chez moi chez toi. Je suis un escargot. » Si les moyens techniques le permettaient, ils prendraient également leur coin de pelouse avec le cerisier au milieu, la niche, le chien, la rue qui mène à l’épicerie et l’épicier. Pour être certains de retrouver, là où ils vont, tout ce qu’ils ont quitté. Il serait plus simple de leur prêter quelques vaches en carton, d’installer une cascade sur place et de disposer harmonieusement quelques bacs de géraniums.
La route me tire de ces railleries. Le vignoble de Bex se rapproche à vive allure. Tout à coup, juste après un virage en épingle à cheveux, j’y suis. Dans les vignes ! Je longe des murs de pierres sèches, ce paysage si familier. Il me vient alors une soif terrible, qu’un bon verre de blanc vaudois saura calmer. Je m’installe à la première terrasse et me mets au soleil pour sécher la brume qui colle encore au blouson. Je tombe sur un journal périmé qui raconte comment les cyclistes du Tour de France sont dopés. Devant tant d’ironie, j’enfourche une dernière fois ma Suzie et lui dit : « Au galop, prends la ligne droite. » Puis j’ai chanté : « I’m a poor lonesome cowboy so far away from home. » Un quart d’heure plus tard, j’étais chez moi et Suzie a rejoint son garage qu’elle n’a jamais quitté depuis.
Gabriel Bender, sociologue et historien.