Émile Chabrand, notable de la vallée de l’Ubaye, entreprend en 1882 un long voyage qui le ramène au Mexique, où il a déjà passé vingt ans, via l’Inde et l’Extrême-Orient. Dix ans plus tard, il publie le récit coloré de ce tour du monde et se voit primé par l’Académie française.
Ce texte est extrait du chapitre XXIV de l’ouvrage d’Émile Chabrand De Barcelonnette au Mexique – Inde, Birmanie, Chine, Japon, États-Unis (1892, Plon, Paris), dont une réédition fidèle à l’original a été publiée en 2008 sous le titre Le tour du monde d’un Barcelonnette (1882-1883), par Ginkgo éditeur et le musée de la Vallée (avec une introduction de Pascal Mongne et une présentation de l’auteur due à Hélène Homps-Brousse, des gravures originales et des photographies d’époque inédites).
* *
*
Nos jeunes Barcelonnettes, habitués depuis l’enfance à l’idée qu’ils iront à l’étranger, lorsqu’ils atteindront l’âge de dix-huit à vingt ans, partent avec entrain. Ils savent qu’ils trouveront là-bas des parents, des amis, et qu’avec de l’honnêteté, du travail et de l’économie ils arriveront à jouir d’une aisance qu’ils ne sauraient attendre d’un pays aussi pauvre que le nôtre.
Un léger trousseau dans une vieille malle, six cents à douze cents francs en portefeuille, quelques lettres de recommandation, c’est tout ce qu’ils emportent pour la plupart ; à vrai dire, le capital qu’ils exploiteront là-bas, c’est leur bonne santé, leur instruction élémentaire, mais très réelle, leur esprit d’épargne et leur ferme volonté de réussir. Ils partent en bandes, comme des oiseaux migrateurs, et c’est à l’automne qu’ils quittent nos montagnes pour traverser l’Océan.
Les plus avisés conduisent la petite troupe et la débrouillent à travers la France jusqu’à l’hôtel d’arrivée à Pauillac par Bordeaux ou bien au Havre. Là, il leur faut attendre parfois pendant une ou deux semaines le départ d’un navire à voiles qui les portera en quarante-cinq ou soixante-dix jours de traversée à Vera-Gruz (depuis environ trente ans, ils gagnent ce port par Saint-Nazaire à bord des steamers de la Compagnie transatlantique qui font la traversée en dix-huit ou vingt jours.
Logés à l’entrepont des navires, nos futurs millionnaires vivent de la nourriture des matelots, à laquelle s’ajoutent quelques douceurs que les parents ont glissées dans un coin de la malle. Ils passent le temps à compter leur argent, pour s’assurer qu’ils n’en ont pas perdu ; à causer, à rire, à faire des parties de cartes, à jouer au bouchon, quand le navire ne danse pas trop, à souffrir du mal de mer et à regretter le sol stable et ferme des montagnes qui les ont vus naître, sitôt que la houle commence.
Le pays de fortune
sort de la légende
Vera-Cruz ! Vera-Cruz ! On aperçoit la terre : terre promise ! Le rêve de tant d’années prend corps, le pays de fortune sort de la légende : il est là ! La joie est grande, et l’on ouvre aussi de grands yeux. Admiration qui bientôt se transforme en un véritable ahurissement. À peine débarqués, nos Gavots se trouvent aux prises avec les portefaix qui s’emparent de leurs colis, avec les courtiers d’hôtels qui veulent les entraîner, avec les douaniers qui les retiennent pour visiter leurs bagages. On les dirait tombés du ciel.
Voyant que personne ne comprend le français, ils en sont réduits à leur patois, qui, ayant quelque analogie avec la langue espagnole, leur permet de faire entendre aux douaniers qu’ils n’ont aucune marchandise, et que leurs malles ne contiennent que leurs vêtements personnels.
Avant de quitter le bateau, ils ont compté l’or qui leur restait : le petit pécule est déjà bien réduit. Ils savent qu’il faut fuir à la hâte Vera-Cruz et son vomito, qui ne vaut rien pour les nouveaux venus. Ils partent avec le convoi de muletiers ou de chariots qui portera leurs bagages jusqu’à Mexico. À pied, traînant leurs gros souliers ferrés dans la poussière, le fusil de chasse en bandoulière, le revolver à la ceinture, ils traversent, sous les rayons implacables du soleil tropical, le désert de sable brûlant qui sépare Vera-Cruz de Paso del Macho. Pour distraction, ils ont les milliers de zopilotes et de corbeaux qui se disputent les restes d’une multitude d’ânes et de mulets crevés sur les bords de la route. La route elle-même est pleine d’insectes malfaisants, de scorpions et aussi de serpents à sonnettes dont la piqûre est mortelle.
Aux haltes, pendant que les uns font bouillir la marmite, les autres plument le perdreau, la chachalaca, la codornis et autres gallinacés tués, chemin faisant, d’un heureux coup de fusil, et qui vont s’ajouter à l’ordinaire ; ou bien, si l’on s’est arrêté en quelque gîte indigène, des jeunes gens, malgré le peu d’accoutumance, font honneur avec leur bel appétit à la cuisine du pays. Si les mulets trop las ne peuvent arriver à l’étape, la tente est bientôt dressée, et sur la mince natte qui sert de matelas on s’endort sans se faire prier, en dépit des courbatures.
Ces Mexicains sont encore
d’assez bons enfants !
Les muletiers ont expliqué à nos voyageurs ce que signifient les tas de pierres et les croix qui se dressent sur les bords de la route ; aussi traversent-ils l’œil au guet et non sans quelque anxiété tous ces passages de sinistre mémoire.
Un jour, des Indiens et des métis, armés de vieux fusils à piston, de sabres, de pistolets d’arçon, de lances et de lazos [lassos], arrêtent le convoi et réclament le péage ou droit de passage. C’est un peu avant d’arriver à Perote, et ce sont des insurgés qui crient : « Que vive Santa Ana, que muera Mariana Arista ! » ou quelque chose d’approchant. On acquitte ces droits, on passe, et mes Barcelonnettes de se dire, heureux d’en être quittes à si bon compte : « Somme toute, ces Mexicains sont encore d’assez bons enfants ! » Une autre fois, aux approches d’un petit village, quelques individus à mine suspecte, le bas du visage caché par un foulard, sortent tout à coup d’un ravin, font sur le convoi une décharge qui n’atteint personne et commandent : Arrêtez-vous ! Mais ils sont trop peu nombreux, les muletiers ripostent, soutenus par nos jeunes Alpins qui tirent comme de vieux soldats ; les bandits s’enfuient.
Le lendemain, toujours avançant, la caravane trouve sur la route de Rio-Frio la diligence que les voleurs viennent de dévaliser. Les volés sont couchés à plat ventre, le visage contre terre, les mains attachées derrière le dos, et n’osent même plus relever la tête. Tous ont reçu des coups de plat de sabre, tous ont été tenus en respect pendant le pillage par les brigands qui, le pistolet armé et le doigt sur la détente, appuyaient le bout du canon sur leurs tempes, tandis que d’autres les dépouillaient de leurs bagages, de leurs bourses et de leurs armes.
Les voleurs ont laissé l’indispensable à ceux qui n’ont pas fait de résistance, et réduit au costume de nos premiers parents ceux qui ont tenté de se défendre. Barcelonnettes et muletiers se mettent en devoir de délivrer les malheureux de leurs liens, quand surgissent vingt-cinq cavaliers, sabre au clair, passant à fond de train au milieu d’un nuage de poussière. Ce sont des cueroudos du voisinage, survenus aux bruits des coups de feu et lancés à la poursuite des pillards.
Le soir venu,
c’est Barcelonnette à Mexico
Ces temps-là sont bien loin, aujourd’hui : les Barcelonnettes ont les bateaux à vapeur d’abord, les chemins de fer ensuite ; leur voyage est moins pittoresque : grâce à la sage administration de ses gouvernants, le Mexique n’offre plus pareilles péripéties aux amateurs d’émotions.
Cependant, notre petite troupe arrive à Mexico, et là elle se disperse. Les uns se rendent directement chez le parent, chez l’ami qui les attend ; les autres s’en vont loger dans une chambre d’hôtel, mais ils sont tout au moins invités à prendre leurs repas à la table hospitalière d’un compatriote.
Ce jour-là, les membres de la colonie voient arriver l’heure de la fermeture des magasins avec impatience : on va pouvoir causer avec les pays. Et le soir venu, vraiment, c’est Barcelonnette à Mexico. Questions et réponses se pressent, sur celui-ci, sur celui-là. Les jeunes émigrés racontent comment ils ont laissé le père, la mère, les frères, les sœurs, cousins et cousines jusqu’au quatorzième degré. On commente les mariages récents, les changements de position, en un mot tous les faits divers survenus dans la vallée. C’est le patois, le cher patois qui résonne ; il a gardé toute sa saveur de terroir dans la bouche des nouveaux venus, il ravive tous les souvenirs : il n’existe plus d’autre langue. On déguste en commun l’extrait de genièvre qu’un des arrivants a tiré de sa malle, on mange les belles pommes rouges de calville apportées du pays natal, et l’on rit de la naïveté des mères qui envoient à leurs enfants au Mexique des pantalons et des bottines de France.
* *
*
Émile Chabrand, voyageur du monde
Né le 18 mars 1843 à Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), ce fils de douanier aura été négociant, collectionneur, voyageur, photographe, inventeur, ornithologue et préparateur naturaliste, seule qualité qu’il revendique. À l’âge de 13 ans, il s’engage comme mousse puis s’installe au Mexique « quand les chances étaient plus hasardeuses », dans la foulée des premiers Barcelonnettes négociants en textile. De retour au pays en 1881 nanti d’une petite fortune, il fait construire une villa à Barcelonnette, installe un musée pour la superbe collection d’oiseaux achetée à un abbé ornithologue, puis, devenu veuf, entreprend seul, en 1882-1883, un tour du monde en 324 jours : Inde, Birmanie, Chine, Japon, États-Unis et, enfin, le Mexique, « pays aimé » qu’il prend alors le temps de parcourir. Curieux et cultivé, Chabrand fait œuvre de naturaliste (reconnu par ses pairs), d’ethnographe, voire d’archéologue. Il s’intéresse à la faune, la flore, les mœurs des populations et leurs productions artisanales, amassant une collection qu’il augmente au cours d’autres voyages (Afrique du Nord, Russie, pays nordiques, Allemagne, etc.) et qui vient enrichir son musée. Ce passionné d’oiseaux tente même de construire une machine volante. Sans succès. En 1892, le récit de son grand voyage, De Barcelonnette à Mexico, reçoit le prix Montyon de l’Académie française. Candidat malheureux à un siège de député, Chabrand met fin à ses jours le 1er septembre 1893. Il lègue à la commune son musée qui, outre les oiseaux et animaux naturalisés, contient des fossiles, coquillages, minéraux, armes, divinités, monnaies, etc. ainsi que de nombreuses pièces d’art populaire, notamment mexicain. Ce fonds forme le noyau de l’actuel musée de la Vallée, qui consacre en outre une salle à ce personnage éclectique.

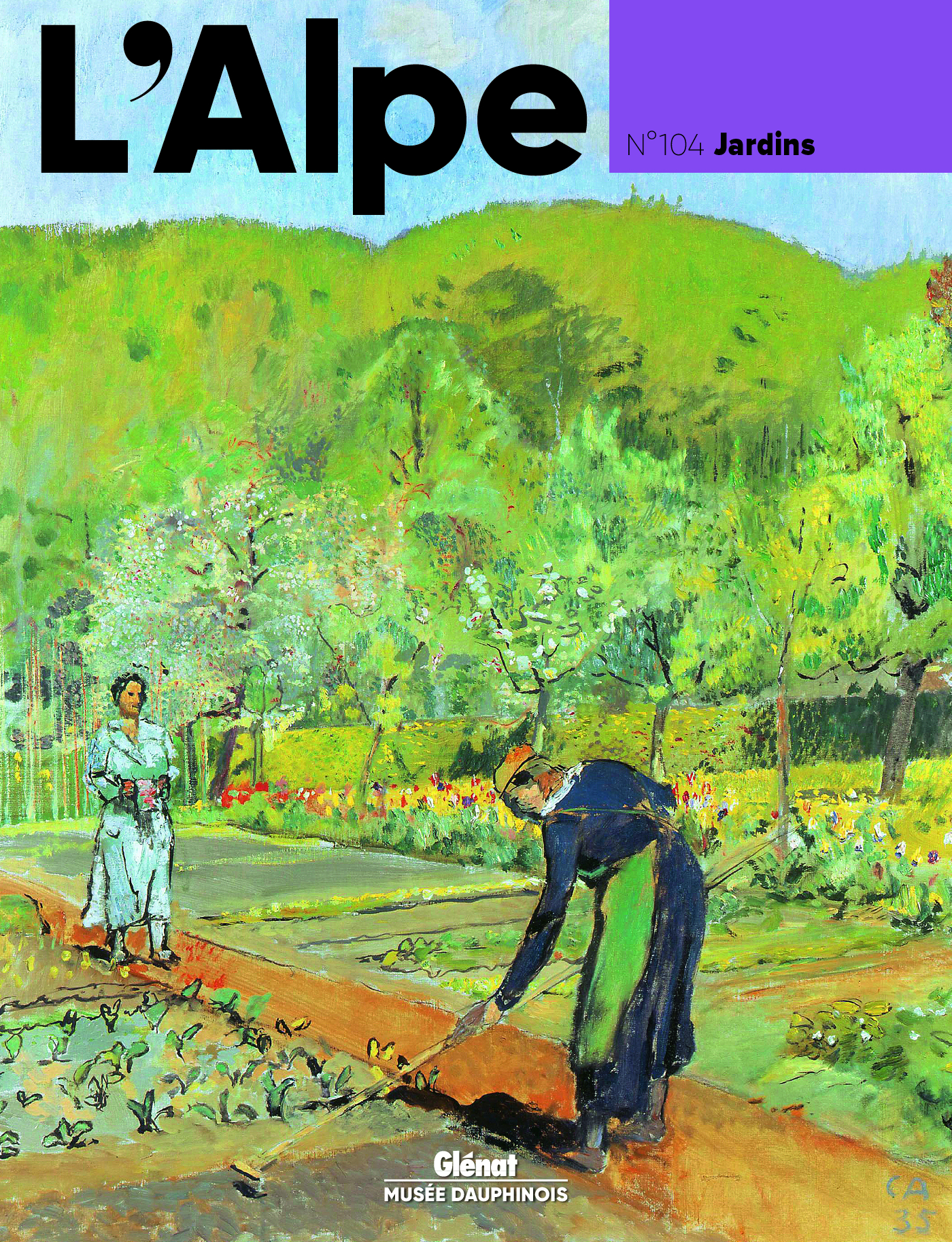

Bonjour,
Je fais partie, moi, des descendants des Italiens de la vallée d’Aoste partis, eux aussi, en groupe en janvier 1911 du port de Gênes pour Vera Cruz avec un transit à Ellis Island. Mon grand-père, Noé Bordet, parti cette année-là, est mort en mai de la même année au Mexique mais je ne sais où. Je suis partie au Mexique il y a quelques années de cela après avoir transité par Barcelonnette (j’habite Valence). Toutefois je n’ai rien trouvé qui puisse me dire où se trouve la tombe de ce grand-père (tombe dont j’ai la photo). Si vous avez quelque document que ce soit concernant la colonie italienne, je vous serais reconnaissante de me le communiquer.
Merci d’avance ,
Monique Bordet-Delauney
Le Mexique est un pays riche en culture, bien évidemment grâce à cette mixité entre les peuples aztèques et les espagnols. Merci pour cet article fort intéressant.
Au Mexique on trouve une grande diversité à tous les niveaux… Et toutes les croyances des Mexicains, par exemple les croix sur les routes que vous évoquez, reflètent la grande foi de ce peuple en dieu et dans un avenir meilleur…