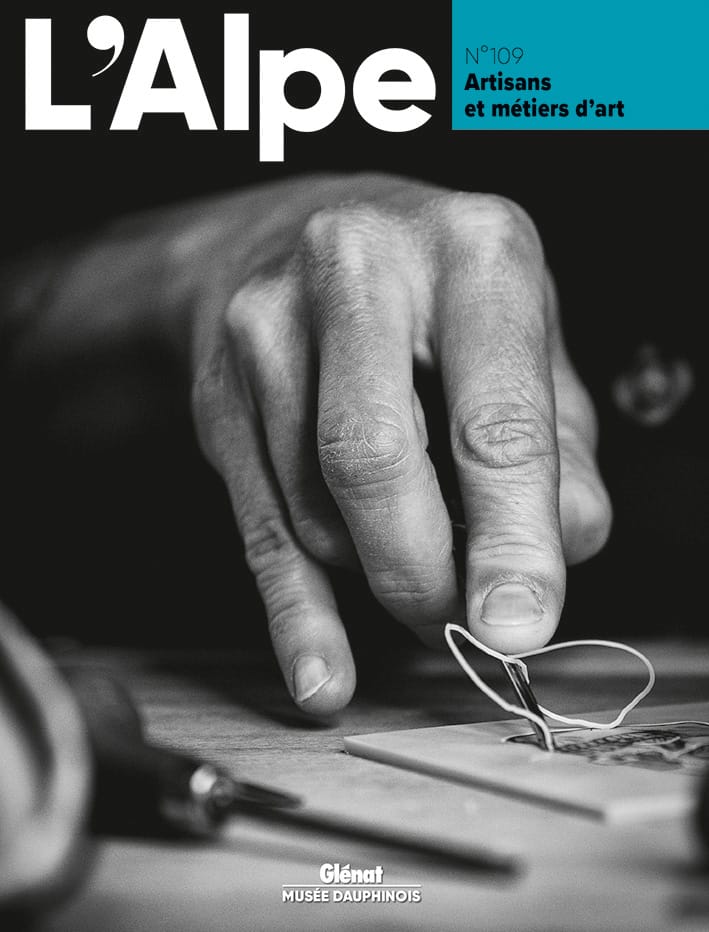Héritage oublié, le patrimoine industriel peine à se faire une place dans le paysage culturel alpin. Si les bâtiments désaffectés commencent à susciter l’intérêt du public et des acteurs locaux, une véritable politique de réhabilitation reste à inventer, en étroite corrélation avec la mémoire ouvrière qui s’y attache. Car les usines et leurs hommes sont une composante essentielle de l’histoire des régions de montagne
C’est au détour des années 1970-1980 que les cheminées d’usine ont été soudainement élevées au rang de patrimoine. Que s’est-il passé pour que ce monde industriel naguère honni, ce symbole de l’aliénation humaine devienne tout à trac… beau ? Ou du moins mérite, à l’instar des églises et des châteaux, de prendre place parmi les monuments historiques ? Pour utiliser une image habituellement réservée à la montagne et à sa découverte, nous sommes passés directement de « l’horrible » au « sublime ».
Le mouvement est certes bien connu, pour avoir été d’abord à l’œuvre en Angleterre (Ironbridge, dans le Shropshire, étant l’archétype de ce que l’on nommait encore l’archéologie industrielle) avant de se diffuser sur le continent. On sait qu’il est lié aux processus de désindustrialisation, accentués aujourd’hui par les délocalisations massives. S’il n’est pas comparable à celui qui a été conduit pour la disparition des sociétés paysannes, le travail de deuil est en cours.
Cette patrimonialisation présente toutefois un caractère original : elle n’a pas été définie par les historiens et autres conservateurs, mais par les « anciens » de ces industries en déshérence, revendiquant la prise en compte de leur patrimoine. Puis elle a été confortée par les jeunes gens qui, de loft en squat, se sont plu à reconvertir les anciennes installations industrielles. La demande sociale a été plus efficace, en la matière, que les politiques culturelles qui peinent encore à suivre.
Sans revenir jusqu’aux forgerons de La Tène*, force est de reconnaître que l’activité industrieuse a toujours été présente dans les Alpes. Rares sont les fonds de vallée où l’on n’a pas mis en œuvre des « artifices » utilisant l’eau abondante et sa force motrice. Les martinets de forge, les moulins et autres foulons ont essaimé partout, développant des savoir-faire réputés, mais aussi une économie étroitement complémentaire de l’agropastoralisme.
Pour le seul travail de la fonte et de l’acier, nombre d’innovations techniques sont issues de foyers industriels alpins : la Styrie et la Carinthie, dans les Alpes autrichiennes, ou Bergame, au pied des Alpes italiennes, ont vu la mise au point de certains types de haut- fourneaux. Comme le Dauphiné qui, à défaut de pouvoir revendiquer l’invention du soufflet hydraulique (fièrement nommé « trompe dauphinoise », mais aussi… « catalane » dans les Pyrénées et « toscane » en Italie !), a vu l’apparition des aciers électriques à la fin du XIXe siècle, juste après la mise en œuvre de l’hydroélectricité sur les mêmes sites. Et l’on ne peut évoquer ici (la liste serait longue !) les extractions de minéraux à des altitudes improbables, depuis les âges des métaux, ou ces autres grandes filières que sont la papeterie, le textile, le ciment ou même la chimie.
Usine ou chalet d’alpage ?
Une histoire à bien des égards prestigieuse, propre à marquer en profondeur l’image et l’identité du massif. Et pourtant… Les représentations de l’industrie ne font pas partie de l’imagerie contemporaine des Alpes. Comme si, dans le cadre d’une valorisation exclusivement touristique, l’usine n’avait pas sa place sur une montagne « naturelle » ; comme si elle ne pouvait résister à la concurrence de l’alpage et du chalet. L’exemple du Valais (relaté dans l’article suivant), où la référence industrielle est pratiquement gommée, témoigne avec éloquence de ce déni historique et de cette identité sélective.
On ne s’étonnera donc pas que les politiques publiques ne laissent guère de place à la protection et à la mise en valeur des vestiges matériels de l’histoire industrielle. Seules quelques filières ont bénéficié d’une relative reconnaissance et ont vu l’installation de musées ou la mise en valeur de sites. Rien toutefois qui puisse prétendre rayonner au-delà du massif, voire d’une seule vallée, et porter une image globale de l’activité industrielle passée. On est en droit de s’étonner de ne pas voir les pouvoirs publics déployer sur ce thème quelques-uns des efforts qu’ils consentent pour le patrimoine fortifié ou le patrimoine rural, pour n’évoquer que des « nouveaux » patrimoines. À défaut, ce sont donc des associations, ou de petites collectivités, qui conduisent ces programmes, de ce fait très modestes.
Il faut certes convenir que la protection du patrimoine industriel et sa mise en valeur ne vont pas sans quelques difficultés. Les seules dimensions des édifices de production suffisent à refroidir les ardeurs les plus vives et les charges d’entretien de ces installations ne sont effectivement pas à l’échelle des projets culturels. Autre difficulté, celle d’un patrimoine technique conservé à l’arrêt, ne fonctionnant plus : c’est la « machine froide », celle qui se dégrade beaucoup plus vite que la « machine chaude ». La question ne se pose pas, on l’imagine, pour les églises, que les communautés conservent à tout prix, même en l’absence d’activité religieuse.
Reste la possible réaffectation des bâtiments industriels, seule solution viable hors de toute vocation culturelle. Il faut cependant beaucoup de talent aux architectes pour imaginer la conservation des formes anciennes tout en les aménageant pour des usages contemporains. Nombre d’édifices pourraient pourtant, à moindres frais, trouver de nouvelles utilisations, publiques ou privées.
On ne s’étonnera pas que l’on se réfugie le plus souvent dans la conservation de symboles : le four ou la cheminée sont autant de monuments chargés d’évoquer une activité disparue, au prix de la mise en place d’outils d’interprétation. Mais ce qui échappe le plus souvent à ces efforts de protection du patrimoine industriel, c’est bien évidemment la part humaine. Évoquer les usines des vallées alpines sans rendre compte des modes de vie et de travail de leurs ouvriers, voire des cadres et des patrons, équivaut à ne conserver qu’un témoignage incomplet : la conservation de vestiges est alors une démarche fétichiste plus que conservatoire. Les passions identitaires, comme les émotions esthétiques, s’accommodent de telles sélections. C’est vrai pour tous les patrimoines, et plus encore pour la mémoire collective. Et c’est particulièrement manifeste pour le patrimoine industriel en terre alpine.
JEAN GUIBAL