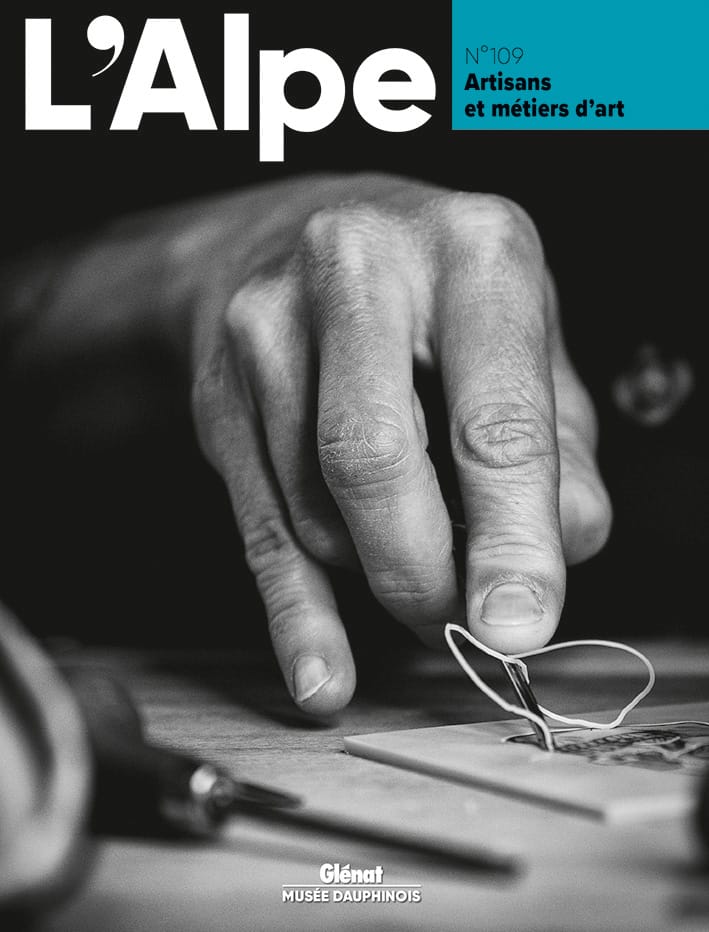Le Vercors, toujours
Il m’arrive souvent de m’immobiliser sur le pont de la Citadelle à Grenoble, face à l’est, paumes sur le granite rugueux de la rambarde. L’Isère roule ses eaux limoneuses jusqu’au moment où elle contourne le bec de la porte de France, survolée par les cinq boules colorées du téléphérique de la Bastille. L’évasement de la vallée est barré au sud-est par la chaîne déchiquetée du Vercors. Au-delà de cette frontière, se cache un plateau gigantesque (cent quarante kilomètres de périmètre, cinquante de long sur son plus grand axe) qui s’étend jusqu’à la Drôme sur plus de quatre cent mille hectares. Je sais tout ça. Entouré de crêtes dentelées et de pics escarpés dont les plus hauts avoisinent 1 500 mètres, le plateau a gagné au cours des siècles une réputation de forteresse naturelle défendue par de solides murailles calcaires. En 1944, on a même osé cette image : un porte-avions en terre ferme. Je sais tout ça. C’est dans le Vercors que le premier maquis de France, ou un des premiers, s’est créé en décembre 1942. En juin 1944, le plateau et ses forêts abritaient plus de trois mille maquisards, dont seulement neuf cents véritables combattants, mal équipés, mais bien décidés à en découdre avec une armée de quinze à vingt mille soldats de la Wehrmacht, appuyés par des SS, des troupes d’élite de montagne et l’aviation, déployée à Grenoble et aux alentours. Je sais tout ça. C’est qu’il faisait belle figure notre Vercors, dit « libéré », au nez et à la barbe de l’occupant. En juin, un immense drapeau français visible de Grenoble avait même été planté sur le plus haut sommet des Trois Pucelles, qui domine la plaine. Je m’en souviens. J’étais mioche, pas encore sept ans, mais je m’en souviens. C’est ma mémoire, celle qui reste. Pas celle de la géographie, celle de l’Histoire, même si elle lui est attachée de manière indéracinable. Ce qui s’est passé dans le Vercors en juillet 1944, je n’ai pas envie d’en parler, de le ressasser. La forteresse sacrifiée. Vous le savez, naturellement. Et si vous ne vous en souvenez pas, si vous n’avez pas appris (les plus jeunes), c’est bien triste pour vous. Pour nous aussi, les anciens. Ceux qui étaient là, déjà. Il m’arrive de le parcourir encore, ce Vercors. Vassieux, qui sent la mort encore au travail dans son dénuement sévère où les âmes peinent à sourdre, la grotte de la Luire qui ne sent plus rien du tout mais où, quand j’avais douze ans, ou quinze, et que j’y montais à vélo, on trouvait encore, éparpillés, des brancards, des casques. Souvent aussi, je me rends au musée de la Résistance et de la Déportation. Où je lorgne en catimini, empli d’un inutile sentiment de culpabilité, d’une nostalgie qui n’est pas de mise, les photos des gars du Vercors (et de Chartreuse, et de Belledonne) alignés dans une clairière comme, dans les années d’après, ces photos de classe avec les élèves dans la cour d’honneur du lycée Champollion, avec leurs cheveux crantés peignés en arrière, leurs chemisettes à col ouvert sur les pulls sans manches et les fameux pantalons de golf. Je me surprends à m’y chercher, désolé de ne pas me reconnaître. Avec cette question, encore et toujours, la seule qui vaille en une vie d’homme, je veux dire la mienne, que je ne peux m’empêcher de me poser, qui me taraude et me hante, et subsistera sous mon crâne jusqu’à mon dernier souffle : qu’aurais-je fait si, en 1942, en 1943, j’avais eu seize ou dix-huit ans ? Qu’aurais-je fait ? Mais les photos restent muettes et le Vercors garde son secret.
Jean-Pierre Andrevon, écrivain, peintre, cinéaste et auteur-compositeur.