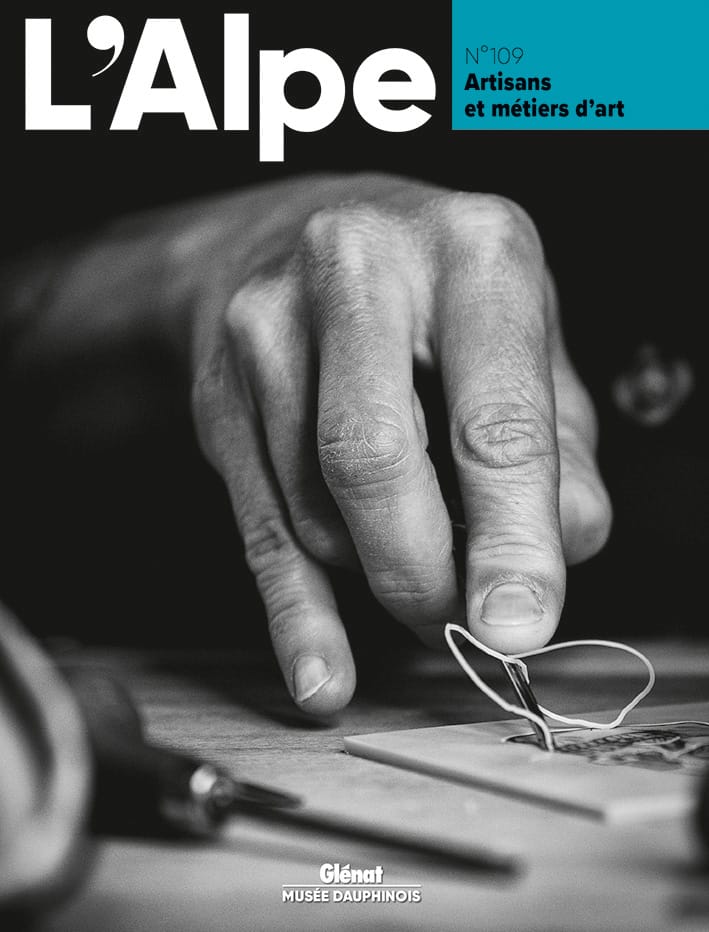Paysages d’origine
Le jeune homme était parti au milieu d’une nuit d’août, en fin de semaine, pour être au pied de la montagne au lever du jour. Il était passé par la cabane de Bounavaux entre 5 et 6 heures du matin. La gardienne, femme d’âge moyen qui séjournait là tout l’été en compagnie d’un vieux curé, son oncle et d’un armailli qui s’occupait des bêtes, le vit monter et nota le fait dans son journal. Elle lui parla sans doute, puisqu’elle précise qu’il voulait faire le Vanil Noir en solitaire.
Le jeune homme suivit le sentier dans les pâturages et parvint bientôt au col de Bounavalette, à partir duquel on se dirige vers l’est pour tourner l’épaule de la montagne. Il n’y a plus guère de végétation. On s’élève en traversant une zone nommée les Roches pourries. La pente est forte et le sol meuble est souvent mouillé ; il faut savoir où poser le pied. Tournant vers le sud-ouest, le sentier prend ensuite sur la crête même. Ce matin-là, 18 août, le soleil était déjà assez haut dans le ciel, le vent était tombé, il commençait à faire chaud. Le grimpeur avait marché trois heures sans faire de pause. Il s’arrêta, essuya son visage avec l’avant-bras, laissa glisser à terre son sac en cuir de vache durci et s’assit sur une pierre. Il sortit du sac un morceau de pain, du fromage, et se mit à manger sans hâte.
Devant lui, les Alpes se déployaient largement, vers le sud, au-delà de la vallée qui s’arrondissait, en bas, avec ses fermes et ses villages. Il voyait les Diablerets et le Grand Muveran, assez proches, et plus loin à droite les dents du Midi comme une borne immense et dentelée sur le bleu du ciel. Derrière la première chaîne, il distinguait les 4000 des Alpes valaisannes, dont les sommets étincelaient. Il reconnaissait la dent Blanche, isolée. Tout à gauche, c’était la chaîne bernoise, avec la triple masse de ses géants, entourée d’autres sommets, comme le Schreckhorn et le Finsteraarhorn. Les glaciers faisaient des taches pâles suspendues entre ciel et terre, petites et étroites dans la distance. Il aimait se dire le nom des sommets, comme des compagnons qu’il aurait appelés un à un. Chacun, solitaire, acceptait l’appel et prenait vie dans son esprit ; et tous ensemble formaient la terre dure et immuable, l’horizon déployé et apaisé. Il pensait que si l’âme existe, c’est dans ces moments-là qu’on la sent.
Il tourna la tête pour apercevoir derrière lui, tout près, le Moléson familier. Au-delà, les Préalpes se cassent, laissant le regard partir au loin, jusqu’à la ligne régulière et bleutée du Jura, tout au fond de la plaine couverte d’un voile de brume. Il était là chez lui, sans personne à qui devoir parler, sans avoir à faire figure, avec sa seule tendresse meurtrie. Il avait l’habitude de tout quitter pour ces moments. Il ne tenait pas à grand-chose de ce à quoi les autres mettent tant de prix, en bas.
Le casse-croûte était fini, il ferma son sac, se leva et se remit en marche vers le sommet, sur l’arête maintenant très étroite. Il regardait attentivement près de lui, à gauche et à droite, sur le bord du précipice qui filait à pic jusqu’aux premiers pâturages : on trouvait parfois des edelweiss dans ces coins-là. Il en cueillit deux dans une anfractuosité qui ménageait un peu d’humus entre les pierres, en tendant le bras au maximum et en assurant bien le pied sur la roche friable, dans la pente. Il savait qu’il y avait, peu avant le sommet, un passage dangereux. Il le connaissait pour l’avoir franchi deux fois déjà. L’arête se cassait brusquement, de biais, et il fallait enjamber une crevasse de trois cents mètres de profondeur en faisant un grand pas. On pouvait s’aider d’une corde que les soldats avaient mise là, accrochée à deux pitons, mais il fallait prendre garde à ne pas glisser.
Il pensa que quand il serait arrivé au sommet, il aurait une vue plus vaste encore que tout à l’heure. Il verrait, au-delà de la dent de Jaman, au sud-ouest, derrière la chaîne des Aravis, le dôme éclatant du mont Blanc qui semblait vraiment être assis comme un roi, commençant à s’élever quand les montagnes alentour se terminaient.
Près de la mère qui pleurait
Dans le journal de ses étés à la cabane de Bounavaux, qu’elle a tenu pendant près de trente années, la gardienne a noté ce matin-là le passage du jeune homme. Elle a consigné aussi, quatre jours plus tard, le mardi, que le père de ce dernier était passé, cherchant son fils qui n’était pas rentré. Le père fit à son tour seul le chemin vers le sommet du Vanil Noir, redescendit. Il revint le lendemain avec une colonne de secours. Les secouristes cherchèrent partout, dans les crevasses et au pied des rochers, dans les pierriers sur les deux versants de la montagne. Le père et son autre fils, l’aîné, revinrent chaque semaine, jusqu’à ce que la neige empêchât les recherches. Ils étaient parfois accompagnés du curé de la paroisse, homme bon que ne rebutait aucune tâche.
La saison suivante, dès que la fonte des neiges le permit, ils revinrent encore, à deux ou à trois, sans se lasser. Il fallait être sûr, on ne pouvait pas laisser la montagne garder le corps. Ils avaient tracé des rectangles sur une carte et examinaient le terrain systématiquement. La montagne sur sa face sud est noire comme son nom, pierreuse, hostile, toute d’éboulis vertigineux.
Ils le découvrirent enfin dans la région des Planex, sur les hauts de Flendruz, le 4 août, par une journée brûlante de canicule. La neige avait disparu presque partout, les plaques au revers s’étaient affaissées ou formaient des ponts grisâtres et malsains, laissant apercevoir le creux des fentes caillouteuses. Ils virent d’abord le sac de montagne et purent dégager le corps recroquevillé le long d’une cassure de la roche. Les membres étaient cassés ou déboîtés suite à la chute de plusieurs centaines de mètres, un côté reposant sur la neige fondue. La partie du côté du froid avait encore sa peau et ses chairs, le visage enfoui contre le sol était brunâtre et émacié comme celui d’une momie. Le reste était du squelette sous les vêtements déchirés.
Avec l’aide des armaillis d’un alpage proche, on confectionna une bière faite de quelques planches, avec un couvercle qu’on cloua en hâte et qu’il fallut déclouer, lorsqu’on eut descendu la bière dans la plaine, pour l’identification légale du corps. Une fois au village où vivait la famille, on procéda à l’inhumation en pleine nuit. Il faisait un orage épouvantable, la foudre sillonnait le ciel, le tonnerre éclatait de partout, un vent furieux soulevait les pèlerines des deux croque-morts qui creusaient. Le père et le frère aîné étaient là avec le curé, sous la pluie battante. Les filles étaient restées dans la maison, près de la mère qui pleurait.
Un regard existe derrière le mien
Cet homme était mon oncle. Je naquis quatre mois après qu’on eut retrouvé son corps et la légende familiale raconte que j’ai remplacé ce jeune mort. Je l’ai « relevé », comme on dit exactement chez certains peuples pour qui les enfants prennent la place des guerriers disparus. Combien de fois ce récit me fut-il fait par ma grand-mère, dont les larmes avaient fini par tarir, et par ma mère ? Combien souvent la photographie de ce corps défait à demi engagé dans une fente de roche, sur le sol gris de la montagne, prise lors de la découverte, ou celle de la bière portée sur un brancard de fortune par deux armaillis, dans le paysage du Pays d’En-Haut, me furent-elles montrées ?
Cette dernière image est devenue comme ma photo de famille, pathétique et fondatrice. Le temps ni l’âge n’ont ici aucune importance. J’y reconnais à chaque fois avec la même émotion les acteurs du drame, le père et le frère aîné, épuisés, qui se sentent tenus de poser devant le photographe, le curé, les paysans même, l’homme et ses deux gamins impressionnés devant l’œil de l’appareil, inhabituel en ces lieux, autant que devant la circonstance funèbre, avec cette boîte au centre de l’image, dans laquelle repose l’homme enfin retrouvé, apaisé, enfin mort. Les femmes sont absentes mais en même temps omniprésentes parce que l’image a été prise pour elles et qu’elles en gouverneront désormais le récit.
Tel est mon paysage natif, telle est « mon alpe ». J’en ai tiré un amour inconditionnel des Alpes, dont je n’ai jamais pu quitter pour longtemps l’horizon, et un goût pour leurs paysages qui ne cesse de susciter en moi des bonheurs nouveaux, des pensées fécondes, en même temps qu’une sorte de mélancolie guette, un sol obscur dont le versant se dérobe. Il y a la face solaire et la face d’ombre des divinités infernales : le goût des vastes espaces aux développements infinis, tandis que les noirs vanils ne s’éloignent jamais pour longtemps, que la teinte sombre des schistes étreint l’âme. Le besoin de lumière, des pentes inondées de soleil, des couchants somptueux sur les falaises calcaires et de la marche heureuse, qui peuvent s’abîmer dans le sentiment de la roche compacte, de la pierre aiguë, de la stupeur minérale.
La légende familiale a noué ces liens entre la montagne et mon inconscient, elle a forgé pour moi, avant que je ne sois en mesure de la comprendre, l’expérience originaire, la perception insue qui fait d’un paysage « mon » paysage. Cette expérience, je la revis quand je marche dans les Alpes ; je la découvre dans certaines images, et souvent elle m’apprend à lire les textes. Un regard existe derrière le mien, qui m’aiguille et m’inquiète.
Métaphores géographiques
En été 2004, à l’occasion d’un ensemble de manifestations organisé dans les Alpes vaudoises sous le nom de Paysages en poésie, j’ai vu des photographies d’Hélène Binet exposées sur de grands panneaux de fer dressés comme des stèles sur la colline du Temple, à Château-d’Oex. Ces photos m’ont touché au cœur, et j’en ai compris tout de suite la raison. Prises à la fin du printemps, au moment du dégel en altitude, elles donnaient à voir une montagne de pentes abruptes aux herbes courtes, de neiges fondantes, de pierriers mouillés, de falaises suintantes. Elles captaient des espaces assombris traversés par une résille de lumière ; des champs obscurs marbrés de taches blanches comme une écriture idéographique ; une falaise dont le soleil rebroussait les stries comme une toile de jute grossière ; un champ de cailloux serrés qu’on aurait pu voir sur une plage du Groenland ; les bords frangés d’un névé montant, telles des vagues, à l’assaut d’une paroi noire…
Ces photographies font apparaître l’élémentaire de la matière, l’élément brut et primitif de la montagne. Elles montrent des textures, la peau rugueuse de la terre et le grain des choses. Elles s’attardent sur l’incertain, l’entre-deux, les processus de décomposition et d’anamorphose, les naissances de la lumière. On se demande souvent face à elles : « Qu’est-ce que c’est ? », avant de réussir à identifier les objets et les espaces. Elles produisent des métaphores géographiques : la falaise alpine devient une falaise marine tombant sur une plage de galets, les couches rocheuses sont des tissus peignés, la neige forme l’arche d’un pont. La perception de l’échelle est troublée : est-ce là un détail ou un vaste espace, le proche ou le lointain ? Elles ne montrent jamais le ciel ni l’horizon, mais obligent le spectateur à rester fixé sur l’espace court qu’elles délimitent par leur cadrage. Elles ne laissent pas non plus apparaître la source de la lumière et n’en font voir que les taches et les lignes, les délimitations momentanées. Ces photographies qui disent si fortement le réel n’ont rien de réaliste et obligent l’œil à chercher ses repères en deçà des cadrages appris et des espaces construits.
Une vision myope des Alpes
Mon regard y reconnaissait évidemment mes paysages inconscients dans leur face d’angoisse, d’autant plus que ces photographies avaient été prises au pied du Vanil Noir, du côté où était tombé le jeune homme qui aurait été mon oncle. Hélène Binet avait saisi la qualité friable de la roche, le processus continu de l’érosion, les teintes noirâtres et morbides des falaises. Me promenant entre les stèles photographiques, sur cette colline qui avait servi de cimetière depuis des temps immémoriaux, j’ai senti une profonde empathie avec la photographe qui avait su capter si remarquablement le sombre génie du lieu. Je garde une ancienne photo montrant toute la pente du Vanil Noir sur le lieu de la chute. Les photographies d’Hélène Binet en sont désormais pour moi comme un second développement, elles en donnent le mode d’emploi optique et la clé sensible.
Il est frappant de constater qu’une partie de la photographie artistique, aujourd’hui, privilégie une approche matérielle élémentaire et comme myope des Alpes, dont je pourrais donner d’autres exemples. Les vastes panoramas et les regards déployés jusqu’à l’horizon ont été exploités jusqu’à plus soif par les images touristiques ou sportives. L’œil des artistes contemporains se porte plus souvent sur la compacité des choses et la perception brute.
Avec ses cadrages mobiles et sa sensibilité aux variations lumineuses, la photographie, particulièrement le noir et blanc, offre à cette démarche un bon outil, plus approprié que la peinture car moins contraint par la tradition de la vue. Pour les Alpes, la peinture de paysage a été l’art des grands espaces et des grands sentiments ; la photographie saisit la trace de l’intime, du proche, de la matière qui contient la mort et la dépasse.
Je remercie Pierre Starobinski, organisateur en été 2004 de Paysages en poésie, pour l’impulsion que m’a donnée son invitation à réfléchir aux paysages des Alpes dans le contexte de la photographie. Je remercie Gaston Sapin et Denise Jaquier-Pittet pour leur aide. Enfin je remercie ma mère, la récitante.
Claude Reichler, professeur de littérature française et d’histoire de la culture à l’université de Lausanne.