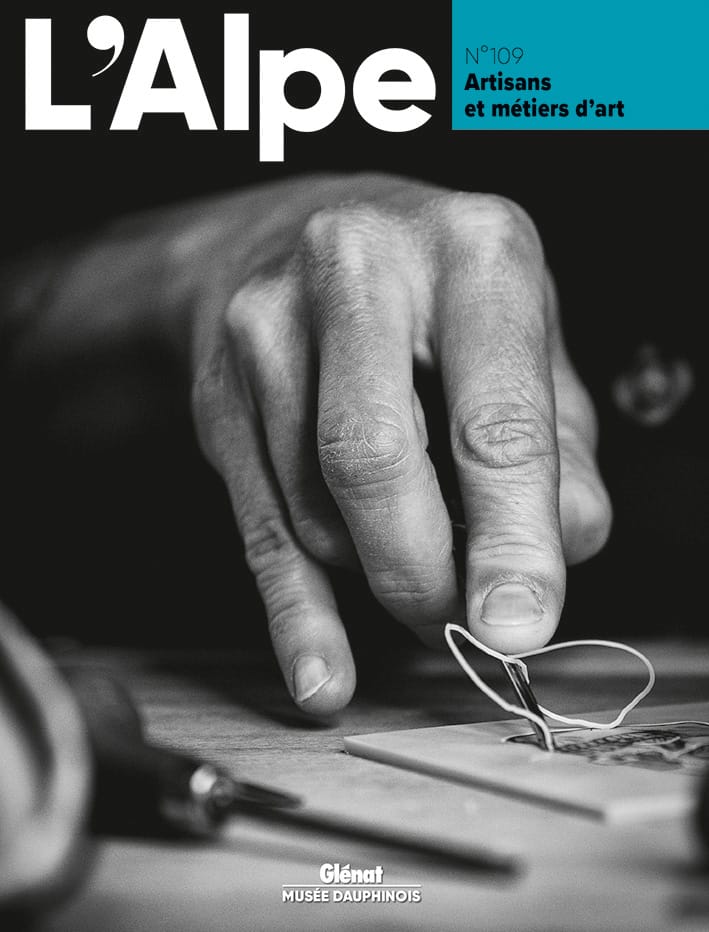Le grand troupeau
Certes, la montagne alpine ne m’était pas étrangère. Des camps de louveteaux en Queyras et quelques séjours en home d’enfants en Suisse à la fin des années 1950 avaient permis au petit Marseillais que j’étais d’approcher ce monde singulier. C’est pourtant au début des années 1970, en suivant des bergers transhumants, que j’eus l’impression de le découvrir, non plus comme un monde étranger, mais comme un espace complémentaire et nécessaire à mon équilibre d’être humain.
Les responsables du parc naturel régional de Camargue, pour lesquels je travaillais alors, projetaient de créer un musée dans une ancienne bergerie. J’en commençai l’étude et fus vite confronté au problème de la restauration d’un tel bâtiment. Comment allait-on l’adapter à ses nouvelles fonctions, sans sacrifier pour autant son âme et son passé de bergerie camarguaise ? Je tentai d’en connaître l’histoire. J’interrogeai les derniers occupants du mas et me vis renvoyé vers le berger qui en avait racheté le troupeau, Constant Belliardo. Je visitai aussi toutes, ou presque, les bergeries de Camargue, apprenant quantités d’histoires sur ces jasses, les hommes et les bêtes. Je découvrais peu à peu les réalités d’un monde double, de Camargue en hiver et d’Alpes en été.
Constant Belliardo louait alors les herbages du mas du Radeau, sur la bordure orientale du delta, entre la rive gauche du grand Rhône, la vaste plaine de Crau et la mer. Une partie de cet espace, dont le mas, venait d’être acquise dans le cadre de l’aménagement du complexe industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. Je trouvai Constant en train de charger des balles de paille. Il m’écouta, les yeux plissés et le sourire aux lèvres, tandis qu’il enroulait des ficelles de balles autour de son avant-bras. « Vous voulez voir la Favouillane ? Montez, justement j’allais apailler », finit-il par me dire en hachant les mots avec un bel accent occitan, celui des vallées provençales des Alpes piémontaises dont il était originaire. C’est ainsi que je rencontrai Constant et découvris le grand vaisseau de sagne et de bois de la jasse de la Favouillane, que nous nous employâmes à sauver ensuite, grâce au concours du port autonome de Marseille et de la population de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Dans l’instant, je décidai de ne pas attendre davantage et de suivre Constant en transhumance pour comprendre enfin comment ces deux espaces de plaine de montagne étaient l’un à l’autre si nécessaires.
Libéré du superflu qui encombre la vie
Nous gagnâmes ainsi le plateau du Vercors par Die, Châtillon-en-Diois et Les Nonières, hameau près duquel les camions s’arrêtèrent vers deux heures du matin. Après un court sommeil sur le bas-côté de la route, près de l’odeur et des plaintes des bêtes encore enfermées, vint le moment du déchargement puis de la montée, lente d’abord, puis de plus en plus rapide au fur et à mesure que l’alpage approchait et que le troupeau tout entier, instruit par les bêtes plus âgées, manifestait sa joie d’arriver.
À midi, nous étions à Tussac, où les bêtes reviendraient à la fin de l’été, et le soir même à l’alpage du Jardin du Roi. Roger Marin, des Nonières, qui travaillait pour Constant et que j’avais rencontré au Radeau, s’y trouvait déjà. Aussi la cabane et la soupe étaient-elles prêtes. Nous passâmes la soirée à parler, avec Roger, et Jean-Marc, le second berger. Appelé par ses affaires et peut-être aussi par ses conquêtes, ainsi que le soupçonnaient ses bergers, Constant redescendit aussitôt vers Arles.
Cette première expérience de la transhumance et du passage d’un univers à l’autre, de la chaleur étouffante et de l’activité fébrile du mas du Radeau au silence, à la fraîcheur et à l’isolement du Jardin du Roi, me fit d’emblée l’effet d’une régénération physique et mentale. Ce fut comme si, libéré de tout le superflu qui encombre la vie, l’heure était venue de ne plus s’occuper que de l’essentiel. « Tu devrais aller voir nos voisins, à Chamousset », me dit Roger le lendemain. « C’est facile, tu prends la direction de l’est, là, derrière la cabane, et quand tu verras deux grands cairns, tu passeras entre les deux et tu y seras. » Ce que je fis le lendemain matin, après un déjeuner rapide mais bienfaisant, dans l’air vif et bleuté des hauts plateaux du Vercors.
Chamousset. Probablement y a-t-il du chamois (chamous en provençal) dans le nom de cette cabane, à moins qu’on ait voulu désigner la cime, la montagne (chamoux, en Dauphiné), ou bien que le nom vienne des deux à la fois, du provençal et du dauphinois, du lieu et des chamois qui le peuplèrent au temps de quelque chasse seigneuriale. Plus subjectivement, ce nom et son douillet suffixe invitent à la quiétude, au repos, à la retraite…
Je commençais à douter de trouver la cabane quand elle m’apparut, soudain, dans un repli du plateau. Surpris, je savourai un instant la vision rassurante de cet îlot d’humanité : la petite cabane et sa cheminée fumante, les chiens assis devant la porte ouverte, le parc, au-dessus, et tout près, en train de m’observer, une impressionnante troupe d’ânes… Allais-je troubler cet équilibre ? Y aurais-je une place ?
Comblé de nourriture,
mais aussi de chaude amitié
Il était dix heures et les rayons du soleil commençaient tout juste à réchauffer la cabane. Pierre Téllène, qui comme Constant avait emmontagné la veille, déjeunait en compagnie de quelques-uns des éleveurs qui lui avaient confié leurs brebis et l’avaient accompagné jusque-là. Je fus immédiatement invité à partager leur repas matinal. Peu après, Pierre me proposait de redescendre avec lui et tandis que nous cheminions, sac au dos, nous fîmes connaissance. Je fus impressionné par cet homme et sa façon d’évoluer, tant elle témoignait d’équilibre et de connaissance du sol qu’il foulait, et d’harmonie dans sa relation avec celui-ci.
Je savais, aux intonations de sa voix et aux tournures de ses phrases, que je parlais avec un Provençal. Mais tout dans sa façon d’être montrait qu’il était chez lui dans ces montagnes. De temps à autre, il s’arrêtait pour me parler, agitant son bâton au bout du poignet, écoutant attentivement mes réponses. D’emblée, je fus touché par sa disponibilité. Il s’adressait à l’inconnu que j’étais encore avec une confiance et une générosité dont je lui serai toujours reconnaissant et que je ne voudrais jamais décevoir. Nous devînmes amis.
Un peu plus bas, au Jas des Vaches, nouvelle halte chez Mimile, le vacher, qui nous invita aussi à partager son déjeuner ; il ne pouvait être question de le lui refuser ! Là, Pierre retrouva le vieux fourgon Citroën avec lequel il faisait les trajets entre Vaucluse et Vercors. Le mauvais chemin alors caillouteux du vallon de Combeau nous conduisit jusqu’à Benevise. J’y retrouvai ma voiture et saluai Pierre, non sans avoir promis de le revoir. Repassant dans mon esprit tout ce que je venais de vivre depuis la veille, je suivis paresseusement son fourgon.
Au bout d’une heure de route, il me fit signe d’arrêter. Nous étions à La Charce, aux confins de la Drôme. « Tu mangeras bien un morceau ? » Heureux de prolonger cette rencontre, je le suivis vers une maison blanche et trapue. Tandis que je tentais d’en lire l’enseigne délavée, « Épicerie Magnan », j’entendis une voix sonore et joyeuse témoignant de la surprise et du plaisir de voir Pierre. C’était celle de Marguerite Magnan. Avec Louis, son époux, ils accueillaient les bergers du temps de la transhumance à pied. La chaleur de cette nouvelle rencontre, les rires généreux de Marguerite et le sourire débordant de bonté de Louis sont un cadeau de plus dont je suis redevable à Pierre.
Compte tenu des trois déjeuners du matin, je me serais contenté de peu. Mais les plats se succédaient… Impossible de refuser de reprendre du pâté en terrine, de la saucisse, des olives, du lapin, des champignons, du fromage, des gâteaux, de la pâte de coing, du vin, du café, de la clairette… « Mangez, mangez », me disait Louis en poussant vers moi les noix qu’il cassait. Je repris la route repu et comblé, de nourriture autant que de chaude amitié.
La table s’allonge chaque année,
en marge d’un monde incertain
Pierre m’avait invité à revenir à Chamousset, le premier dimanche d’août, pour le méchoui qu’il offrait à ses amis. Il avait coutume de lancer cette invitation chaque année auprès des éleveurs qui lui avaient confié des bêtes, des bergers voisins, de ses connaissances locales, mais aussi de parents et d’amis de la Drôme et du Vaucluse. Ce méchoui, auquel je participai en 1973, fut suivi de bien d’autres. J’y fis la connaissance de Jeanine ; les compagnes d’éleveurs sont généralement discrètes mais leur rôle, s’il n’est pas toujours visible, n’en est pas moins capital. Je rencontrai aussi Marilyn, Jean-Pierre, Ludovic, Annette et bien d’autres…
Vingt ans plus tard, Pierre a dû restreindre son activité. Il n’est plus « le patron de Chamousset ». Serge Roman, qui lui a succédé tout en continuant de prendre ses brebis en estive, trouve naturel que Pierre continue d’y inviter chaque été ses amis et fête, en cette année 1993, ses vingt-cinq ans d’estive à Chamousset. Depuis la création de l’association des éleveurs ovins transhumants du Vercors en 1989, il semble aussi que des liens se soient resserrés, sinon créés, entre les éleveurs qui fréquentent ce massif. C’est aussi à cette époque, que fut créée, avec l’ami André Pitte, la fête de la transhumance. Mais cela mériterait sans doute d’autres développements…
Chacune de ces retrouvailles à Chamousset, autour de Pierre et de ses amis, de l’agneau grillé et d’une abondance de victuailles et de boissons, m’a toujours apporté le même réconfort. Bien que de nouveaux venus s’installent chaque année autour de la table qui s’allonge à grand renfort de planches, de volets, de bûches et de bidons, cette réjouissance garde son ambiance propre. Ainsi, jamais ce repas ne s’est achevé sans qu’entre les rires, les bons mots et les chansons, de graves questions soient posées. Où va le monde ? Qu’y faire ? Qu’y changer ? Comme si l’amitié qui nous réunit là, devant cette cabane d’alpage, en marge d’un monde de plus en plus incertain, offrait ce qu’il faut de force pour affronter le désolant constat de l’état de l’humanité.
Curieusement, on en repart toujours un peu plus fort, d’abord parce qu’il est consolant de partager ses angoisses existentielles, mais surtout parce que le climat d’amitié fraternelle, qui soude le temps d’un repas tous ceux que Pierre a réunis, est propice à l’apparition d’une force de résistance propre à rendre l’espoir. « Soyons frères, non parce que nous sommes sauvés, mais parce que nous sommes perdus », écrit le philosophe Edgar Morin dans Terre-Patrie.
Il y a de cela dans les rencontres de Chamousset ; la conscience que s’il existe un salut pour l’humanité, c’est grâce à de pareils moments de communion. Ils ne sont pas seulement des lueurs d’espoir dans la fin d’époque que nous vivons, ils nous ont aussi déjà permis d’accomplir de grandes choses : l’association des transhumants du Vercors, la fête de la transhumance à Die, la Maison de la transhumance à Saint-Martin-de-Crau… Autant de rencontres et de projets qui doivent leur existence à ces moments de pause estivale, dans la montagne alpine. Aujourd’hui, à 89 ans, Pierre ne peut plus monter à Chamousset, mais il y est toujours en pensée car nous en parlons chaque fois que nous nous voyons.
Jean-Claude Duclos, directeur du Musée dauphinois et du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère.