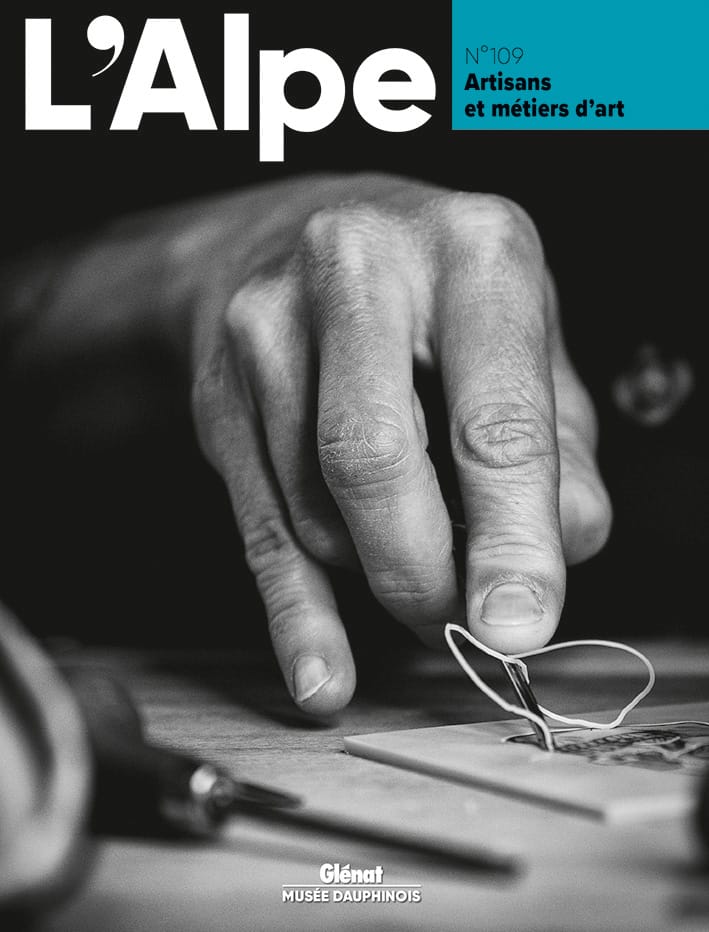L’effet Zeigarnick
« Et après tout, quelles significations ont donc les montagnes? Elles sont toujours demeurées hors de nous, ne nous ont jamais appartenu, ne répondent jamais à l’amour que nous leur portons. Je crains qu’elles ne soient, elles aussi, qu’une illusion. » Dino Buzzati.
J’aurais peut-être dû renoncer. Mais bon ! Le mauvais temps avait gâché mes vacances et voilà qu’au cœur de cet été pourri s’annonçaient quelques jours de beau temps, et tous les désirs rentrés, tous les projets différés, tous les rêves suspendus affluaient et me remplissaient d’impatience. Je voulais aller à la Meije, et je devais trouver un compagnon de cordée pour cette ascension, mais le mois d’août avait dispersé mes partenaires habituels, et je courais les terrasses de bistrots de Grenoble, cherchant désespérément un ami, un visage. Un jour, deux jours passèrent, bêtement perdus sous un ciel d’un bleu impitoyable. Au matin du troisième jour, j’ai rencontré Michel.
« Michel, quel bonheur. Je t’attendais. Tu tombes à pic. »
– J’ai un peu peur quand tu m’abordes de cette façon. Tomber à pic, c’est une expression que je n’aime pas beaucoup. Qu’est-ce que tu mijotes encore ?
– Ne t’inquiète pas, c’est du cousu main, une promenade de santé, une voie normale.
– Mais encore ?
– La Meije, tu verras, c’est fantastique, c’est tranquille, je n’ai que toi, il faut sauter dans le beau temps, partir aujourd’hui. Allez, viens. Tu viens ? »
Le temps de convaincre Michel, de préparer nos sacs, d’assurer le ravitaillement, de chercher une paire de crampons, de réserver nos places au refuge du Promontoire, nous sommes partis tard de Grenoble, trop tard sans doute, surtout qu’il y avait un bouchon au Bourg-d’Oisans. On a pu attraper au vol le dernier téléphérique à La Grave, gravir, encordés, les Enfetchores, mais là, je ne connaissais pas l’itinéraire, on est monté trop haut, on a dû rebrousser chemin, et quand nous avons pris pied sur le glacier, les premières lueurs du couchant illuminaient la montagne, si bien que nous arrivâmes à la brèche de la Meije de nuit. J’avais dans la poche de mon anorak une photocopie de la description par Gaston Rébuffat de notre course, où l’on pouvait lire : « À la brèche, on retrouve non seulement le soleil mais un paysage de soleil, et la descente sur le refuge se fait dans une impression de détente. »
Nous y étions dans l’obscurité et le froid, avec une seule lampe frontale pour deux, qui diffusait une pâle lueur à trois mètres de distance et nous laissait entrevoir des gouffres insondables. Combien de descentes amorcées, de replis hâtifs, de tentatives avortées, de lassitude et de découragement. Heureusement, Michel ravalait sa rancœur et restait muet, mais nous y serions encore si le gardien du refuge du Promontoire, ayant aperçu le manège erratique de notre loupiotte, n’avait laissé ouverte la porte du refuge pour que nous puissions nous guider à son éclat. Incertitude, fatigue, angoisse, tout est balayé en un instant, nous marchons allègrement sur la trace qui mène au refuge. Soudain, un cri. Michel vient de tomber dans la seule crevasse qui barre le chemin, à vingt mètres à peine de la porte du refuge. Il a eu juste le temps de se bloquer en écartant les bras. Je l’extirpe de sa gangue. Il est vraiment temps que nous retrouvions la chaleur des hommes, le réconfort de la nourriture, l’accueil d’une couche douillette. Notre programme est à l’eau, mais nous sommes saufs. Provisoirement.
Le lendemain, levés tard, nous redescendons jusqu’au refuge du Châtelleret, deux heures de marche assez tranquille. Mais si nous voulons retrouver notre voiture à La Grave, nous devons remonter jusqu’au col du Clos des Cavales. Trois heures et demie de grimpette, le versant est à l’ombre, la dernière pente en neige très dure et nous devons chausser les crampons. Il ne nous reste plus qu’à redescendre, nous laisser glisser vers les sources de la Romanche. C’est à cette ivresse que Michel s’abandonne, slalomant sur les pentes de neige ramollie par le soleil, jusqu’à ce qu’une plaque de glace traîtresse le surprenne. Il se récupère tant bien que mal, les bras en sang, et nous continuons, hésitants, une descente qui nous paraît très vite interminable. Au pied du col, Michel abandonne, à bout de forces. Je lui laisse mon sac, encore deux kilomètres pénibles sur la route goudronnée pour aller chercher la voiture, qui consent à démarrer. La suite n’est qu’une longue rumination lestée de fatigue et de douleur sur notre échec, notre fatuité, notre impréparation, notre imprudence.
Cette aventure, ou plutôt cette mésaventure, est vieille de près de quinze ans. Et pourtant elle est là, cette montagne de douleur, tapie au fond de ma mémoire, vive comme si née d’hier, éclipsant tous les sommets sur lesquels j’ai pu poser un pied vainqueur, inscrite dans mon corps recru de fatigue, saisi de froid ou exténué de chaleur, somnambule ajoutant pas après pas, montant, descendant, remontant, redescendant, sans autre but que de revenir à mon point de départ. Mais je dois remercier l’effet Zeigarnick, qui veut que les choses inachevées se rappellent à nous de manière plus insistante que les choses achevées, l’effet Zeigarnick encore une fois vérifié et qui me remplit de tendresse pour notre entreprise calamiteuse où, notre orgueil dans notre poche, nous nous sommes soumis aux contraintes austères de la montagne, et c’est ainsi que nous l’avons aimée.
Jean-Olivier Majastre, anthropologue, université Pierre-Mendès-France, Grenoble.