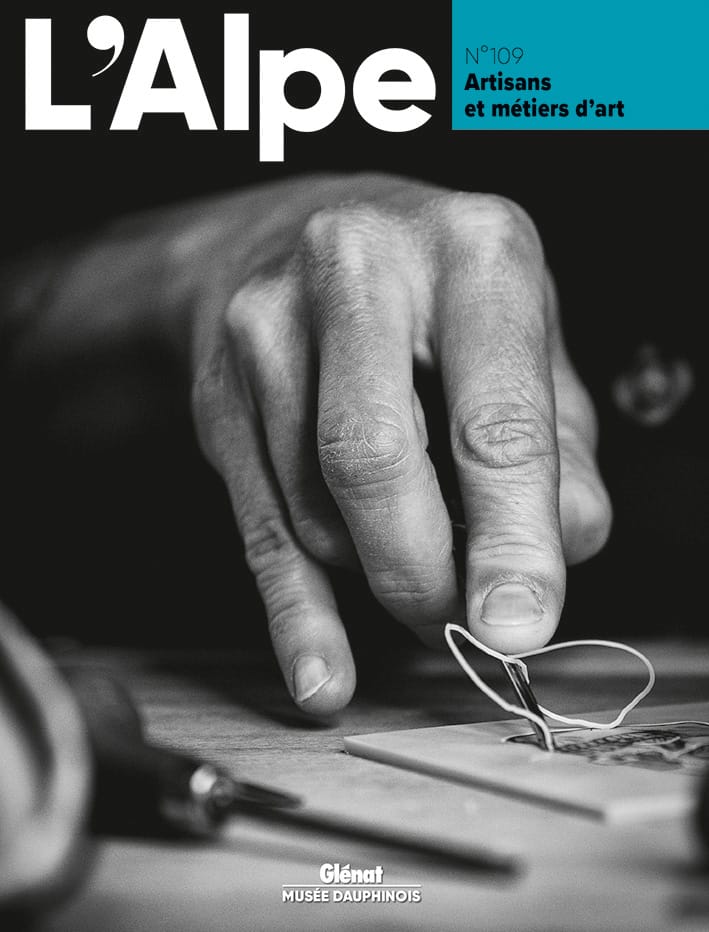Te souviens-tu, André ?
Quand tu m’as annoncé, voici dix ans, que tu fondais L’Alpe, j’ai pensé que c’était dans l’ordre des choses. Tu régularisais sur le papier ton union avec la montagne que tu tentais d’apprivoiser depuis si longtemps. Et finalement, c’est elle qui a eu ta peau, et même ta dépouille tout entière. Cela aussi, c’était dans l’ordre des choses. Te souviens-tu de ce jour irréel de janvier 2006 ? Nous te portions en terre par un froid de loup, au pied du colossal Glandasse, saupoudré de neige et rose d’un pâle soleil couchant d’hiver. Glandasse, la montagne que tu avais si souvent gravie en suivant le chemin muletier vertigineux que descendaient jadis les colonnes, extraites là-haut dans le Vercors, des monuments romains de Die. Glandasse, taillé dans ce calcaire urgonien aussi dur et coupant que les pierres sauvages du Thoronet. Au cimetière de Die, tu es sous la protection de la formidable muraille. Tu es aussi au pied des cuves de la cave coopérative, ce qui est la moindre des choses pour qui a tant chanté à gorge déployée : « Et la tête sous le robinet… » Tu te reposes enfin un peu en attendant la résurrection de la chair, ce jour où nous n’aurons plus besoin de l’affection des montagnes, où nous serons au-dessus de la mer de nuages. « Et face à face te verrai », chantions-nous aussi naguère sur la musique céleste de Bach.
Les Alpes, tu les as découvertes à vingt ans. Tu en rêvais, tu voulais en baver, pousser comme toujours ton corps dans ses retranchements. Tu as demandé à accomplir ton service militaire dans les chasseurs alpins. Envie de prendre de la hauteur, envie de neige immaculée, envie de dompter la bête. Tu n’as pas été déçu du voyage, mais pourtant au retour des manœuvres épuisantes dans le Mercantour, tu avais encore de l’énergie à revendre et du la dépensais en faisant le mur de la caserne du 27e BCA à Nice. Au mitard, tu avais ensuite le loisir de méditer les devises du bataillon qui t’allaient comme un gant : « Vivre libre ou mourir » et « Toujours à l’affût ».
La rage des Alpes ne t’a plus quitté. À l’école, le frère Robert t’avait surnommé « le rapide ». Bien vu ! Un jour où tu nous rejoignais pour une brève permission à Saint-Paul-sur-Ubaye où nos parents avaient choisi de passer les vacances, tu es parti seul, en pleine nuit et sans carte, pour gravir les 3 409 mètres de l’aiguille de Chambeyron : pari réussi. Tu es rentré éreinté et heureux en nous décrivant, avec ton excitation habituelle, le bonheur de fouler les millions de trolls jaunes des alpages et la vipère sifflante qui avait failli te mordre.
Te souviens-tu du vieux père Signoret qui nous logeait dans sa maison branlante du fait d’un récent tremblement de terre, près de l’église dont la voûte s’était effondrée ce jour-là juste après la sortie de la messe ? Il nous racontait sa jeunesse en Ubaye à la fin du siècle d’avant et tu buvais ses paroles, tu rêvais de choisir un jour une vie semblable, ta décision était déjà prise. Il n’avait jamais oublié ce soir de neige où, se rendant au hameau de Maurin, au bout de la vallée, il avait été poursuivi par une meute de loups qui le talonnait. Maurin, un bout du monde, un peu comme La Bérarde en Oisans. Pour s’y rendre, on passait à Fouillouse et son cimetière, à l’entrée duquel on est peut-être encore accueilli par cette forte inscription : « Passant, souviens-toi que nous avons été ce que tu es et que tu seras ce que nous sommes. »
Des enfants et des copains,
et des livres par milliers
Et puis 1968 est arrivé, la crise de nerfs des petits bourgeois repus du baby-boom et le chant du cygne des vieux gamins nostalgiques de l’existentialisme. C’est comme cela qu’à vingt-six ans et déjà père de trois belles filles, tu percevais l’atmosphère du temps, depuis le quartier du Palais-Royal, à Paris, où tu habitais dans une soupente. Exit la Babylone de tes années folles. Escale au pied du Jura dans l’immense et glacial moulin de Verjon pour t’endurcir encore un peu le cuir comme ouvrier apiculteur. Au lieu d’un cilice que tu aurais porté si tu avais été ermite, tu aimais les piqûres de tes chères abeilles. Elles te fascinaient : tu n’as jamais cessé d’être un animal social, aimant à vivre en bande, tenant table ouverte, même quand tu n’avais pas grand-chose à partager.
Mais le Jura n’est que le contrefort des Alpes qui t’appellent. Serge, le complice des jours anciens, t’a précédé à Jonchères, en Diois, où, à la mode du temps, il élève des chèvres. Va pour Jonchères. L’austérité du lieu te va bien. Une ruine à l’abri de la bise sera ton repaire. Il n’y a que quelques mètres à gravir pour découvrir le Glandasse (déjà !) dans toute sa majesté. Tu choisis d’être bâtisseur : des enfants, beaucoup d’enfants, des murs de pierre, partout, des livres entassés par milliers et, toujours, des copains et des copains de copains, des nuits entières passées à refaire le monde. Tant va la cruche à l’eau, si l’on peut dire car Jonchères en manque et l’on n’en boit guère chez toi, qu’arrive le jour où le principe honni de réalité te rattrape. Il faut déposer la truelle, descendre dans la vallée et changer de vie. Pendant la vingtaine de tes dernières années, tu partages alors tes Alpes, comme éditeur, comme catalyseur de talents et d’énergie, et tu déplaces encore quelques montagnes, exploits dont ces quarante-trois numéros de L’Alpe conservent la trace.
À ton rythme, les années comptent double. Tel un patriarche de la Bible, tu auras vécu cent vingt-six ans. Reviens vite, André. Au pied du Glandasse, nous campons, prêts à repartir dans les verts pâturages du vallon de Combeau, sur ces hauts plateaux du Vercors où rien ne saurait plus nous manquer. À tout de suite.
Jean-Robert Pitte, professeur de géographie à l’université Paris-Sorbonne, vice-président de la Société de géographie et membre de l’Institut.