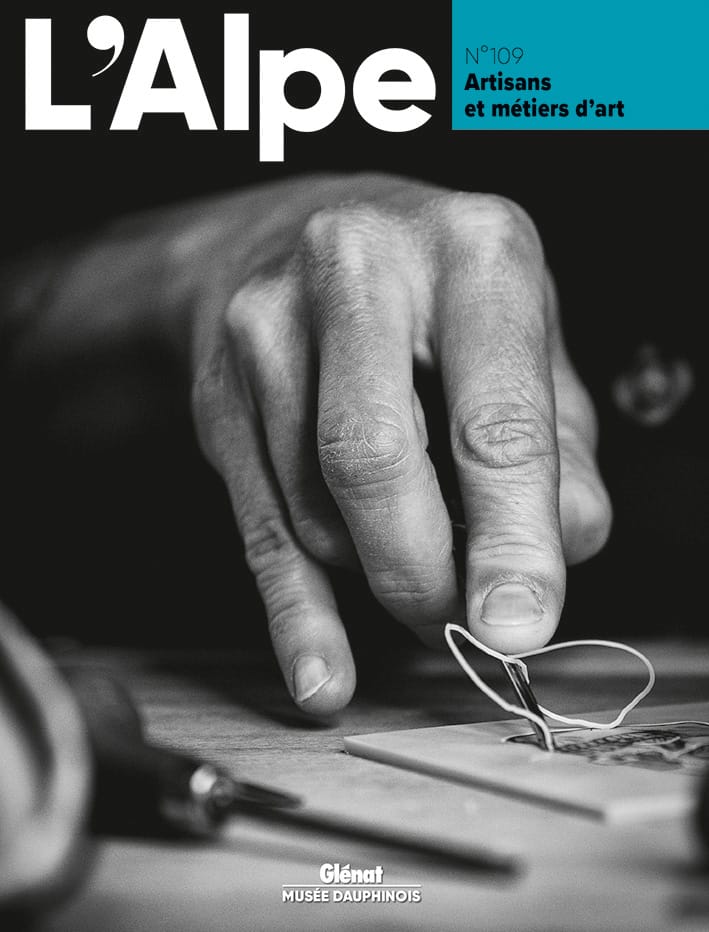Hors du temps
Combien de fois en ai-je rencontré qui, lorsque je dis venir de Grenoble me répondent : « Quelle belle ville ! » Au début, on se demande de quoi ils parlent. Existerait-il une cité homonyme idyllique, quelque part au fond des Appalaches ? Et puis, on s’habitue. Parce que ces gens émerveillés ajoutent aussitôt : « Le cadre est superbe… la montagne ! » C’est vrai qu’elles sont belles nos montagnes, au point de faire oublier à ceux d’en bas la grande banlieue de béton bien plate qui étouffe entre leurs pentes verdoyantes. Ah, la montagne ! Elle est le bol d’air, de verdure et d’espace qui fait rêver ceux qui se trouvent pour quelque temps affectés dans ce qu’un rédacteur de Wikipédia décrit comme « une ville champignon qui a poussé à la plus mauvaise époque de l’architecture ». Cette montagne, je ne suis pas le dernier à en profiter. Mais malgré les années, malgré ses paysages, elle n’est pas vraiment « ma » montagne. Le randonneur est un peu comme les oies du biologiste Konrad Lorenz : sa montagne, c’est la première qu’il voit en sortant de l’œuf. Si belles que soient nos montagnes dauphinoises, pour moi il leur manque un petit quelque chose. J’y cherche en vain un mazot, un village de bois où tintent les cloches des chèvres derrière une porte vermoulue, le doré des arolles sur les pentes… Car ma montagne de Proust est valaisanne. On n’y connaît pas la tartiflette et on peut y boire sans arrière-pensée un vin du pays. J’en entends qui sourient. C’est vrai que le Valais est une image d’Épinal. Une carte postale ou un emballage de chocolat pour touriste japonais. Ainsi est faite la Suisse, avec ses géraniums aux balcons de belles fermes au bois sombre, patiné par le temps, et ses petits trains rouges qui sifflent dans les « contours ». Dès qu’on s’écarte de la plaine du Rhône, défigurée par l’industrie, les vallées s’ouvrent vers le haut, vers des pentes semées de villages blancs et bruns. On y trouve de la vigne en altitude et l’indigène est encore parfois paysan… même si le fromage à raclette vient parfois de la France voisine. La sortie de l’œuf, ce fut le val Ferret et le col du même nom, avec les Grandes Jorasses dans le fond. Une carte postale, vous dis-je. Il m’a fallu bien des années pour comprendre que les gens pressés qui allaient dans l’autre sens étaient des sportifs qui faisaient le tour du Mont-Blanc. Il est pourtant difficile d’être pressé dans ces montagnes, où l’on s’attarde si facilement devant une table, au point de finir dans la nuit certaines courses commencées trop tard ; où j’ai une fois été nourri à la cabane Dufour par des inconnus prévoyants qui avaient porté sur leur dos plusieurs menus pour être sûrs de satisfaire tout leur petit monde, avant de redescendre avec eux, en joyeuses glissades sur les névés. Il y a peut-être dans tout cela un peu de nostalgie, mais dans ma mémoire, où quand j’y reviens, je ressens toujours l’impression d’une montagne marquée davantage par le plaisir que par le sport, par une certaine lenteur paysanne plutôt que par le stress de la performance. L’ombre de Charles-Ferdinand Ramuz semble planer dans le Valais central. Un rythme lent, une fascination de la lumière, la sensation d’une montagne qui serait restée longtemps hors du temps. En quelques lieux, le passant s’abandonne au temps, à l’imaginaire ; et au simple plaisir de rester là, immobile.
Michel Tarpin, maître de conférences d’histoire de l’art antique à l’université de Grenoble.