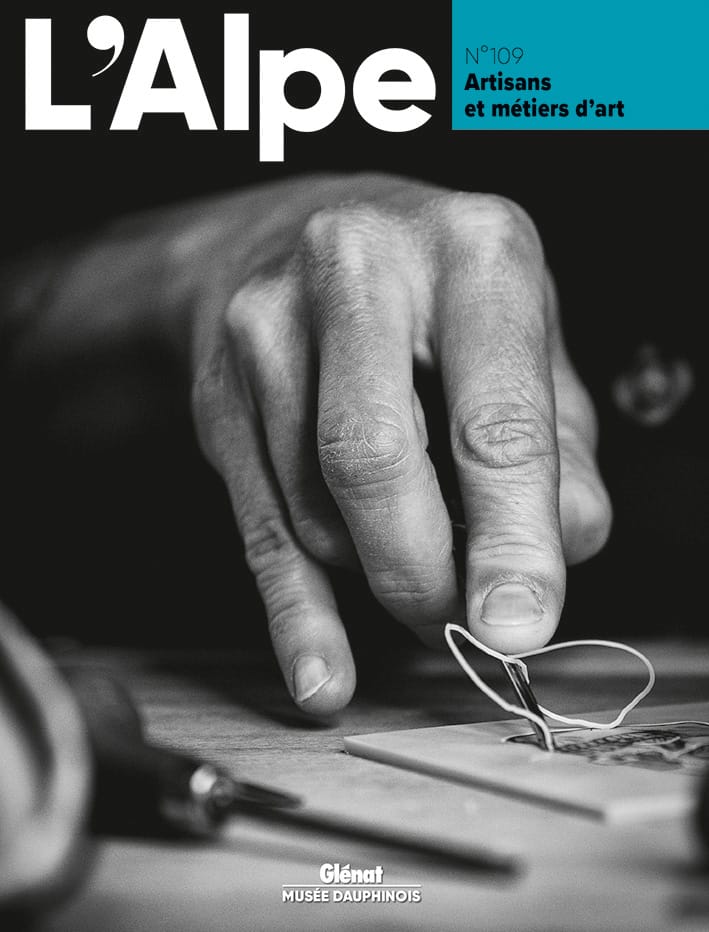Gentille Alouette
Mon alpe est dentelée comme les aiguilles de Chamonix et les buissons de rhododendrons, limpide comme les lacs des Chéserys ou le ciel d’automne au sommet du Buet, craquelée comme le glacier du Tour ou la table d’orientation du Brévent, glauque comme les lichens sur la protogine ou les intrusions de basalte aux Diablerets, majestueux comme le glacier d’Aletsch ou le long schuss de Saas Fee, bavante comme les trois monts Blancs ou les limaces de mon jardin, saupoudrée comme le sirocco sur un névé ou la bruyère dans l’herbe rase, ondulante comme vue d’un avion pour Venise ou une marmotte sortant du terrier, cisaillée comme l’Afrique sur l’Europe ou mes jambes à la descente, suspendue comme le Grand Plateau ou les câbles de l’aiguille du Midi. Mon alpe est un paradis d’enfance de Parisien, la quête d’un souvenir primordial et révolu, l’aboutissement du tour d’horizon, l’aire de la grande grimpe de la vie. Mon alpe est le rire chuintant d’une cascade, mon rire ventral quand une ascendance secoue mon parapente, le pacage d’une passion.
Mais mon alpe intime chahute plus que ces sensations égrenées que tant de chantres plus habiles ont su recomposer. Un jour d’août 2008, à l’aube. Une pale d’Alouette III heurte le rocher du Grand Capucin. Atterrissage en catastrophe. C’est une Alouette comme celle qui m’a sauvé la vie il y a vingt-huit ans.
Un jour d’août 2005. Je retrouve Yvon, qui est monté à Paris aider les enfants désœuvrés à gravir un mur d’escalade posé en plein stade de France. Nous nous reconnaissons tout de suite. Je pleure intérieurement tandis qu’il me sourit de loin. Son chien d’avalanche est mort il y a dix ans déjà. Il n’a pas oublié ce matin de juillet et me tend les diapositives qui en ont fixé pour toujours la trame irréelle que je croyais effacée. J’ouvre l’enveloppe et regarde dans le soleil estival les tâches rouges dont je suis constellé sur les petits carrés de plastique. Je pensais avoir surmonté depuis longtemps et découvre l’étendue douloureuse de ce choc intime, tel ce nerf si court qui paraît si grand quand un dentiste vous le dévitalise. Je regarde Yvon et le remercie. En rangeant les prises de vue dans leur enveloppe, je tremble une dernière fois : me voilà libéré. Mon alpe intime redevient verte, démêlée par une brise apaisante.
Un jour d’août 2003, Michel m’ouvre son petit carnet. Il en possède une dizaine où son écriture minutieuse encre le fil de sa vie et ancre sa mémoire. « Le 24 juillet, s’exclame-t-il, j’ai retrouvé la date ! À huit heures du matin. Vous savez, comme j’étais directeur technique, il y a eu une enquête après et j’ai été longuement interrogé. » Je tente de distraire l’inévitable et pourtant injuste culpabilité de Michel. Ému, il me montre le tracé rouge, car il écrivait en rouge et non en noir les événements tranchants de son existence, des mots de sa main qui détaillent un brin de mon histoire.
Soleil noir dans l’alpe rouge
Un jour de juillet 1980. Mes yeux s’ouvrent au bruit des ciseaux. L’infirmière découpe ma chemise pour ne pas me l’ôter, ne pas me faire mal. L’odeur n’est plus celle des myrtilles sous la rosée mais celle, universelle, de l’antiseptique blafard qui hante les hôpitaux. Je suis à Chamonix, je le sais encore. Je gémis et dis que cela doit s’arrêter. Le chirurgien m’explique qu’on ne peut pas m’endormir tandis que mon lit roule jusque dans une petite pièce blanche. Une seringue anesthésie mon bras droit. « Tu te pinces et quand tu ne sens plus rien, tu m’appelles. » J’ai peur. J’appelle car je dois le faire maintenant que mon bras est un bout de bois. À quatre, les infirmiers me portent sur la table. Inerte, je contemple le scialytique circulaire dont les lamelles de lumière m’hypnotisent et me dégoûtent.
Pendant trois heures, je n’aurai rien d’autre à regarder et mes yeux ne pourront se fermer alors que mon corps est violenté. On panse à gauche ; on tire, on gratte, on coupe et l’on plâtre à droite. « Vingt coupures sur le crâne, un tympan crevé » ponctue un médecin. « Quel âge as-tu ? – Quinze ans. Pourquoi es-tu monté là-haut alors que c’était interdit ? » gronde le chirurgien tandis qu’il me recoud le menton. L’aiguille en arc de cercle paraît énorme dans ma peau fine. Je compte les points dont chacun me transperce à cru. Je sais que son reproche masque son chagrin de me faire mal. On me relève et je vomis mon alpe intime et rouge, mon accident.
Le temps passe avant qu’un ronflement berce la cime des épicéas. Plusieurs hommes descendent au bout d’un câble. L’un me fait une piqûre, pour aider mon cœur explique-t-il. Un autre me parle gentiment. Il s’appelle Yvon. Il veut que je lui dise où j’ai mal. Il prend des photos pour la gendarmerie. On me déplace lentement jusqu’à la civière, bras croisés pour m’emmitoufler dans une toile chaude et ocre. Les pales tourbillonnent au-dessus de moi ; elles cisèlent un soleil noir. J’ai peur d’avoir le vertige quand s’élève ma civière qui tourne sur elle-même. Des mains l’agrippent et dans un grand claquement, me mettent à l’horizontale. L’hélicoptère m’emporte et me soulève l’estomac.
Je me réveille dans un cauchemar, seul, sans mon frère, assommé de douleur au point que la réalité ne peut être cela. Je repose bizarrement sur les ancrages en pierre de taille, cernés de mousses et de branches de sapins. Je tourne lentement ma tête vers la droite et vois des bulles de sang sur ma chemise bleue, bizarrement tendue vers le haut. À gauche, comme une fumée légère au-dessus de mon bras noir dans la fraîcheur du matin. Je sombre. Daniel arrive et me parle doucement. Le cauchemar est réel. Mon frère est descendu le prévenir et il a appelé les secours.
Dans un grand arc de quinze mille volts
Il est six heures du matin. Je suis heureux de me lever tôt. Avec mon frère, nous partons faire un reportage photographique et lever un mystère : explorer les restes du téléphérique des Glaciers. Depuis des années, les pylônes tournés vers l’aiguille du Midi, les pierres de taille surplombant le glacier des Bossons et les gros câbles rouillés qui ne relient plus rien me fascinent. J’y vois l’ardeur des ingénieurs à vouloir atteindre les sommets, le terrain ludique de petites découvertes. J’y mesure l’éternité de la montagne à peine égratignée, la brièveté des hommes dont l’œuvre n’est déjà que ruines et abandon.
À sept heures et demie, nous visitons ce grand manoir austère qu’était la station de la Para. Une odeur de mouton couvre les effluves de graisse industrielle. Machineries métalliques, escaliers de granit, cabines en bois abîmés par le temps dévoilent un geste prométhéen que la nature aurait voulu sanctionner. Les sapins cachent la façade sud de la gare. En escaladant le premier pylône qui la domine, la vue serait dégagée. Me voilà déjà sur l’avant-dernière poutrelle, le bras gauche enserrant le pylône, le droit réglant l’objectif de mon appareil, ma tête deux mètres sous ces trois câbles parallèles qui conduisent quinze mille volts et qui vont bientôt, dans un grand arc, m’électrocuter. J’appuie sur le déclencheur…
Mon alpe intime n’est pas une belle course de haute montagne ni un tragique accident d’alpiniste. Elle paraît loin de « la conquête de l’inutile » et de la noblesse des chutes de spécialistes aguerris. Pourtant, elle m’a fait toucher du doigt la mort, la souffrance et la brutalité de l’imprévu. Mon alpe intime est une Alouette III brisée sur le glacier qui fait écho à ma propre chute et me rappelle que l’alpe dépasse l’homme.
Pierre-Louis Roy, employé à la direction de la stratégie de la SNCF, passionné d’histoire de la montagne, collectionneur, auteur des ouvrages L’aiguille du Midi et l’invention du téléphérique et Mont-Blanc Express aux éditions Glénat.