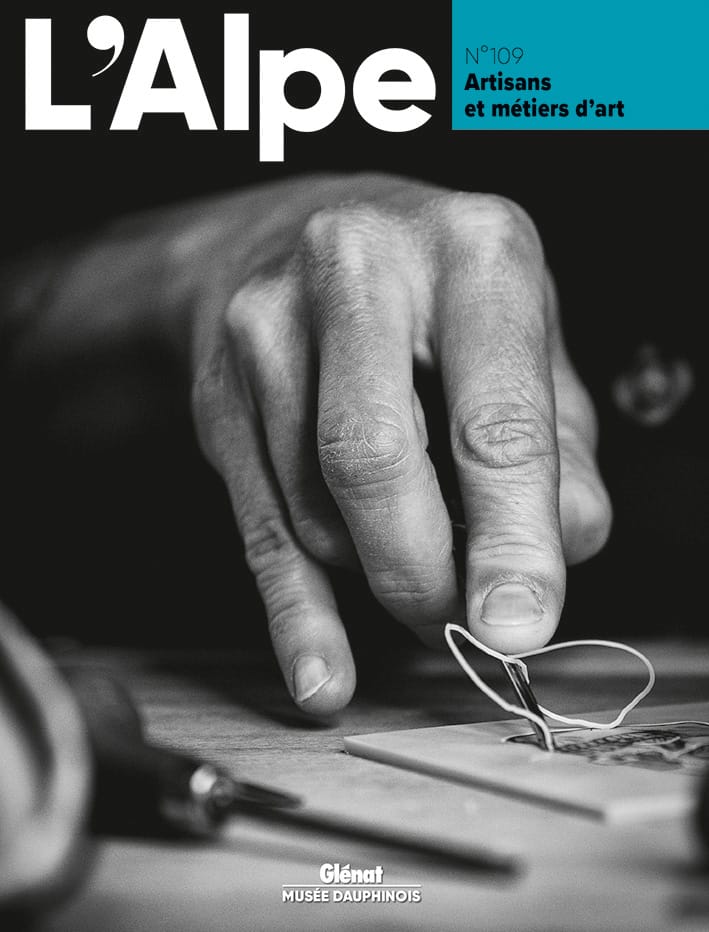L’autre rive
Le soleil a bien baissé. Il fait encore bon, mais les ombres sont déjà longues. Celle de la grande arête rocheuse, à elle seule, a déjà avalé la moitié du versant d’en face. On est secs depuis longtemps. Même nos serviettes ont eu le temps de sécher. Les quelques jeunes qui se baignaient un peu plus loin sont partis. Nolwenn se lève comme si de rien n’était, rajuste sa barrette dans ses cheveux noirs et met nos affaires dans le sac à dos : « On y va ? » Je regarde encore un moment le lac avec un reste d’espoir, mais à la seule vue de l’eau profonde je sens l’angoisse revenir, monter, s’apprêter à me submerger à nouveau, même là sur la terre ferme ! Ça suffit pour aujourd’hui.
Peur dans l’eau, moi ! Il faut longer la berge un bon moment avant d’atteindre le vague sentier dans l’éboulis. La végétation est dense. Nolwenn marche devant d’un bon pas, mais en veillant à ce que les branches qu’elle repousse ne viennent pas me fouetter. Par endroits, des buissons d’épineux nous barrent le passage, on doit redescendre jusqu’au bord du lac et sauter de rocher en rocher. Nolwenn a toujours été agile, mais là elle a une légèreté, une grâce. Un vrai chamois. Elle a la forme, elle, en ce moment.
Je n’y ai pas fait attention jusque-là, mais il serait difficile de ne pas les entendre maintenant, en s’approchant : des mouettes, remontées de la Méditerranée comme tous les automnes. Tout un groupe tournoie, sans doute au-dessus d’un banc d’ablettes. À tour de rôle, l’une puis une autre se met à voleter sur place, puis replie à demi les ailes et pique dans l’eau. Un concert de cris. Tellement familier pour moi. Une musique qui ne me quittera jamais. L’odeur de garrigue flottant dans l’air laisse place à celle des embruns, je nageais seul depuis longtemps. Le plus souvent, Max avait fait demi-tour dès la bouée verte : « Tu comprends… Mon père… »
Petit bouchon au milieu des molosses
Dix brasses, vingt brasses, cent brasses, les rochers défilent devant moi les uns après les autres. D’abord ceux que je connais depuis toujours, où je vais pêcher les crabes aux grandes marées, puis le premier îlot, le rendez-vous des goélands, une bande d’herbe tout en longueur perchée au sommet d’une ceinture de falaises, puis le deuxième, beaucoup moins haut, gros caillou à demi noir de moules. Il est déjà nettement moins abrité, celui-là, c’est rare qu’il ne soit pas entouré d’écume. Encore des brasses, encore et encore, et bientôt ça y est, je reconnais au passage une sorte de tête au nez crochu, la sortie de la baie, la frontière, le début de la mer, la vraie, le vent du large, rien d’autre en vue que la houle, les vagues, parfois de vrais murs d’eau, jusqu’à l’horizon. Je me laisse flotter, monter et redescendre de creux en bosses, petit bouchon de rien du tout au milieu des molosses, aussi heureux que dans la niche de Melchior et Milou quand j’étais tout petit, quand je dormais entre leurs pattes ou qu’ils me débarbouillaient à grands coups de langue.
Le vague chemin remonte presque tout droit dans l’éboulis, ne tournant que pour éviter quelques chênes verts. On ne s’est toujours pas dit un mot. Nolwenn slalome entre les blocs de calcaire blanc. Elle n’a pas ralenti en attaquant la pente, au contraire. Décidément, elle a la forme, en ce moment. Puisque c’est comme ça, je vais lui donner le sac à dos. On a déjà pris pas mal de hauteur, peu à peu la vue s’élargit. Nolwenn s’arrête devant une touffe d’hysope, plante qui parfume sa tisane préférée, se met à choisir les plus beaux brins. À nos pieds, le lac continue en amont comme en aval, aussi loin qu’on peut voir. Des eaux profondes, sombres, des berges abruptes avec une multitude de petits fjords, de criques, de recoins. La rive d’en face surtout est sauvage. Comme tout le versant d’ailleurs. Si raide qu’il n’y a ni maison ni route, et pas même de sentier, comme je l’ai découvert en traversant le lac pour la première fois.
Je nage le long du bord, n’osant y croire. Pas une trace de passage, rien, j’arrive sur une île déserte ! Et dès le lendemain, avec Freddy, avec de bonnes chaussures dans un sac en plastique accroché à la ceinture. On n’en mène pas large dans la combe qu’on essaie de remonter. Il vaut mieux ne pas tomber. Ni dans le couloir qu’on finit par dénicher à gauche de la grande arête. On n’est pas peu fiers en atteignant le premier niveau de replats. Tellement émus que nos jambes flageolent, mais une fois passée l’euphorie de la découverte… Coincés de partout, bel et bien. Même la grande vire avec des pins, qu’on pensait rejoindre tout de suite, est inaccessible.
Tout l’hiver à ruminer, à s’entraîner sur des blocs près de chez nous. Et aux premiers beaux jours on n’a pas tardé à l’avoir, cette fameuse vire ! Non sans cette déception : une boîte de sardines rouillée. Non, impossible que quelqu’un soit passé avant, elle a dû tomber depuis le haut, ou plutôt un coup de vent l’a apportée là. Il y aura aussi notre première ascension complète, l’année suivante, avec en guise de corde une drisse récupérée sur un bateau… Pas étonnant que j’aime autant la région depuis notre arrivée ici. Sans doute pas la même sensation d’espace qu’en mer, mais le même corps à corps avec les éléments, le même bonheur au-delà de la peur. Oui, une belle jeunesse, de belles années.
Les années Nolwenn
Et encore, ce n’était rien à côté de celles avec Nolwenn, plus tard. Toutes ces journées, ces semaines, dès qu’on peut, plus ou moins au hasard, dans des coins invraisemblables, parfois à faire frémir, surtout à nos débuts, des vires en plein ciel partout dans la région. Les aiguilles noires, le pic Fayol, le col du Verdier, la crête du Colonel, sans crampons ni pitons. Et ce couloir qu’on na jamais retrouvé sur les cartes. Ce culot, tous les deux. Et Nolwenn n’est pas la dernière ! C’est même elle qui avait proposé qu’on s’y lance, dans ce couloir. On avait eu du bol, en tout cas, ce jour-là. Si on n’avait pas réussi à récupérer un vieux piton dans une faille, avant le dernier passage… D’ailleurs, c’est peut-être pour ça que Nolwenn s’est un peu calmée. Mais ces balades, ensuite. Plus paisibles, certes, mais une ambiance… Ces vallons déserts, ces champs de fleurs inouïs, ces bains nus dans les torrents. Et quand la nuit tombe : pas une lumière à l’horizon, pas d’autres bruits que ceux du vent et des ruisseaux. Le bout du monde. Et ces ciels. Puis on se glisse dans notre minuscule bivouac, il fait glacial, on se serre l’un contre l’autre. Et quand le mauvais temps s’y met, comme au Grand Morétan, une nuit, un jour, une nuit, encore un jour, sans se décoller.
Nolwenn a fini de ramasser son hysope, elle vient derrière moi la ranger dans le sac à dos. J’entends la fermeture Éclair de la poche latérale, je sens de petits à-coups dans mon dos, puis une main frôle la mienne. J’ai honte. Il faut que je lui parle. Et le plus tôt serait le mieux… Si ça se trouve, je ne vais pas réussir à rentrer à la voiture. À la pensée des derniers mètres un peu vertigineux en dessous de la route, je me sens mollir, je m’assois. Que m’arrive-t-il, depuis la naissance de la petite ? Ou depuis cette voie qui a failli nous coûter cher, avec René, quand j’avais oublié d’attacher la corde… Mes mains qui tremblent pour un rien, de plus en plus au fil des mois, mon cœur qui cogne à la vue du vide, au point que mes jambes ne me portent plus, même sur des sentiers pour familles, et même dans l’eau maintenant ! Un handicapé, une loque.
Nolwenn est retournée ramasser encore un peu d’hysope. Le soleil passe derrière les crêtes. Le versant d’en face s’estompe. Je regarde disparaître dans la pénombre les eaux profondes du lac, la grande arête, le premier niveau de replats, la vire avec des pins, tout ce qui n’est plus pour moi désormais, quand je réalisé que Nolwenn m’appelle. Elle a un ton un peu tendu, il me semble. Ma gorge se noue. C’est elle qui va me parler finalement. Elle est accroupie un peu plus loin, je la rejoins. Elle tend le doigt devant elle, vers une petite plante à peine plus grosse qu’un pissenlit, dont les feuilles effilées pointant au ras du sol dans toutes les directions forment une étoile : « C’est beau, hein ? » On reste en silence. C’est dur, pour elle aussi. Enfin, elle se décide : « Je sais bien que t’as horreur de bricoler, mais tu crois que tu pourrais installer des jardinières, et aussi une table à rempoter, à la maison ? »
Roland Chincholle, chercheur et écrivain.