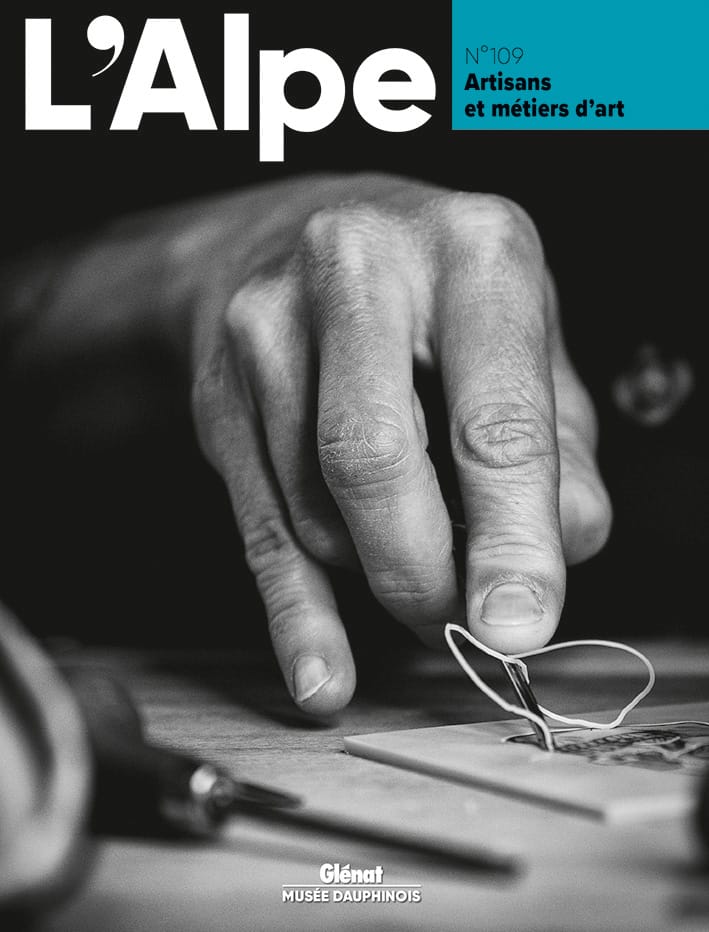L’Alpe et mon père…
Pour L’Alpe, André Pitte m’a un jour fort gentiment extorqué un article dont je découvris après coup le titre énigmatique sous lequel il parut, « Je t’aime, moi non plus. » J’y critiquais la façon dont les géographes français avaient longtemps voulu ignorer les questions géopolitiques, mais aussi paradoxalement fort mal traité les Alpes qui sont pourtant un magnifique objet géographique. Le Français Paul Vidal de La Blache (fondateur de l’École géographique française) les néglige en 1905 dans son Tableau de la géographie de la France, pourtant considéré comme un modèle de description géographique pendant plus d’un demi-siècle. Les Alpes ont droit à seulement dix pages sur trois cent soixante-cinq, il n’est essentiellement question que des grandes vallées, et les noms de quelques grands massifs alpins ne sont cités qu’en trois lignes. Il faudra attendre que Raoul Blanchard quitte la platitude des Flandres et vienne durant l’entre-deux-guerres à Grenoble (il y fondera l’Institut de géographie alpine), pour que les Alpes commencent à être traitées dans la géographie française avec l’égard dû à leurs grands paysages.
J’aime profondément la géographie mais, au risque de paraître iconoclaste, pas les géographes – fussent-ils fameux – qui restreignent ses vraies dimensions, celles d’un savoir primordial. Mon « jardin secret alpin » fait partie de mes souvenirs les plus précieux de prime jeunesse (j’allais avoir dix ans). Je n’ai jamais rien écrit, ni même raconté, à ce propos. Il est étroitement lié à un lieu précis des Alpes et aux quelques journées d’août 1939 que j’y ai passées avec mon père. Mais nous dûmes rentrer au plus vite à Paris, car la guerre allait être déclarée et je ne savais pas qu’il allait disparaître quelque temps plus tard. Il avait à peine quarante ans.
En l’occurrence, l’alpe n’est pas seulement un cadre de vie, mais une force dont l’air insuffle alors la vie dans les poumons rongés par le bacille de Koch, ce que savent les tuberculeux qui ont eu la chance d’aller se soigner en montagne (avant l’apparition de la pénicilline). Mon père, géologue de terrain au Maroc, mais aussi docteur ès sciences puis géologue en chef de la Société chérifienne des pétroles, contracte sans doute la maladie auprès de goumiers ou moghazni (soldats) qui l’accompagnent et partagent ses campements à la fin de la guerre du Rif (1926). Il doit revenir en France pour un séjour à proximité des médecins des sanatoriums du plateau d’Assy, au-dessus de la vallée de l’Arve. Durant plus d’un an, avec lui, ma mère et mes frères, nous habitons à Bay, dans un petit appartement au-dessus d’un café-restaurant. C’est un arrêt pour les cars montant de Saint-Gervais, et qui depuis Passy viennent d’escalader les durs lacets de la route. De ce premier séjour à Bay, je garde surtout le souvenir merveilleux de la neige (nous arrivions du Maroc) qui m’arrive jusqu’à la ceinture sur le chemin de l’école, lorsque le chasse-neige n’est pas encore passé. Il y a aussi Estelle, l’aubergiste, et son mari qui fait des terrassements et me juche sur son gros cheval.
La dernière photo de mon père
Le second séjour à Bay (à peine deux semaines) m’apporte bien davantage : j ‘ai deux ou trois ans de plus et je suis seulement avec mon père (et ma grand-mère, qui est fort discrète), car ma mère est restée en région parisienne à Bourg-la-Reine, avec mes petits frères pour installer le nouvel appartement. Aussi mon père, qui fut déjà mon instituteur plusieurs mois lors d’un autre séjour en montagne et qui ne peut plus faire de longues marches, consacre (me semble-t-il) l’essentiel de son temps à m’expliquer beaucoup de choses. Et tout d’abord les grandes lignes du paysage : au-dessus de la vallée de l’Arve, le glacier des Bossons et le mont-Blanc en arrière-plan, vers le sud-est. Certains soirs, sa coupole reste merveilleusement éclairée par le soleil couchant, alors que les pentes plus basses sont déjà dans la nuit.
Vers l’ouest, l’horizon est marqué par la chaîne des Aravis, zébrée d’éclairs lors des orages. Au-dessus de Bay se dressent les aiguilles de Varens (nommées aujourd’hui Varan) et je rêve de ce désert de Platé, qui en altitude s’étend derrière elles : des couches de calcaire à nu sans aucune végétation, sauf dans les ravines des lapiaz, comme m’explique mon père. Ce spécialiste des nappes de charriage (je l’ai su plus tard) tient aussi à me raconter la formation des montagnes, et j’ai le récit de la dérive des continents et de ses contrecoups même loin des océans, alors que la théorie de l’Allemand Alfred Wegener est encore récusée par la plupart des géologues. J’en ai gardé un intérêt joyeux pour la géologie.
Un jour, sur un sentier, il me met dans les mains son appareil photographique et me dit de faire une photo de lui. J’ignore alors que c’est la dernière. Il m’explique aussi les divers aspects de la végétation, les types de résineux. Lors de nos promenades, nous laissons les grands chalets en bois du vieux village pour nous aventurer dans un bois vers le relais de Charousse, ruine d’un kiosque-guinguette d’origine incertaine. De là, on peut voir, au pied d’un grand escarpement, la vallée de l’Arve après son brusque coude vers le nord. D’un café, sans doute près de Sallanches, monte souvent une même musique, le Boléro de Ravel…
Mais, en cette fin août 1939, il faut écouter la radio pour savoir comment les choses tournent entre l’Allemagne et la Pologne, et il m’explique ce qu’est Dantzig et ce que signifie ultimatum. Je m’amuse du nom du ministre polonais des Affaires, monsieur Beck. « Et s’il refuse l’ultimatum des Allemands ? » « Alors ce sera la guerre » me dit mon père, qui décide de rejoindre au plus vite l’ensemble de la famille. Nous descendons en taxi dans la vallée prendre un train pour Paris, où nous arrivons de nuit. Moins d’un an plus tard, après la « drôle de guerre », il y aura le désastre de 1940.
Depuis, je ne suis pas revenu à Bay, si ce n’est pour un très bref passage. Beaucoup trop de choses avaient changé et j’appris qu’à la fin de la guerre, Estelle, l’aimable aubergiste, avait été fusillée par des maquisards. J’ai voulu, me semble-t-il, sauvegarder le souvenir des moments essentiels passés avec mon père au pied des aiguilles de Varens. En 1950, mes premiers pas de géographe sur le terrain s’orientèrent vers l’héritage symbolique laissé par mon père au Maroc, et plus précisément au pied de ces chaînes prérifaines où dans les années 1930, au lieu de forage qu’il avait choisi, du pétrole avait fait éruption. Ce choix du Maroc fut renforcé par celui de ma femme, elle aussi géographe et future ethnologue, dont la famille durant la guerre avait dû se réfugier dans ce pays. Mais les troubles annonciateurs de son indépendance nous firent opter pour l’Algérie, qui semblait alors plus calme. Depuis la France, la fin des empires coloniaux n’a fait qu’élargir nos orientations intellectuelles et politiques. Mais c’est en Savoie, face au mont Blanc, que se situe le plus profond du souvenir de mon père.
Yves Lacoste, géographe, professeur émérite à l’université de Paris VIII et directeur de la revue Hérodote.