Le cyclisme tourne l’alpage
Longtemps, je n’eus qu’un seul livre. Je veux dire qu’un seul livre comptait à mes yeux ; c’était un numéro spécial du journal L’Équipe édité en 1953 à l’occasion des cinquante ans du Tour de France cycliste. Dépouillé de sa couverture, les pages jaunies, il renfermait toute une mythologie consultée chaque été, tous les matins après le petit déjeuner, sur la toile cirée de la table de la cuisine. Cela commençait lors de la première édition en 1903 avec la victoire de Maurice Garin (dit « le petit ramoneur », originaire du val d’Aoste) et s’achevait en 1952 avec celle du Piémontais Fausto Coppi.
J’ai été élevé dans une religion qui aura bientôt cessé d’être. Une religion latine (aux accents flahutes), ambulatoire et cyclique, dont les héros accomplissaient leurs travaux au fil de la route, particulièrement en montagne, dans les cols. Les noms de mes Hercule (et les surnoms qu’ils ont gagné au gré de leur histoire) : les Italiens Fausto Coppi (« il campionissimo ») et Gino Bartali (« Gino le pieux »), les Suisses Ferdi Kubler (« l’homme cheval ») et Hugo Koblet (« le pédaleur de charme »), les Français André Leducq (« Dédé muscles d’acier »), Antonin Magne (« Tonin la méthode »), René Vietto (« le roi René », dont les cendres ont été dispersées au sommet du col de Braus, après Sospel), Jean Robic (« tête de cuir », qui l’année de sa victoire, en 1947, courait pour la marque Génial Lucifer), Eugène Christophe (« le vieux Gaulois », apparenté à Vulcain), etc. La liste serait longue.
Cette religion avait ses idoles, ses images pieuses et ses images infernales. Je pense encore avec effroi au dessin illustrant cette expression du sport cycliste, « descendre à tombeau ouvert » : un coureur, dans la pente terrible d’une route de montagne, se précipitant vers une tombe à la gueule grande ouverte dans laquelle le sport cycliste s’anéantit tout entier aujourd’hui. Elle avait aussi ses Homère, parmi lesquels l’écrivain italien Dino Buzzati qui, dans ses chroniques pour le Corriere della Sera, a élevé le duel Coppi-Bartali au rang d’une épopée : « Le vieux champion parvenait-il à trouver le salut ? Ou était-ce l’heure où le destin frappait ? Le son d’une trompette retentit, que les échos des rochers répétèrent. Alors, Coppi cessa de se balancer au-dessus de sa selle. Il avait trouvé un souffle nouveau, venu de quelque zone inconnue, la main invisible de la victoire le tira de glacis en glacis, et le poussa dans la descente de la Valle Gardena. Désormais, il volait, terriblement heureux, bien que son visage ne parlât que de douleur » (Sur le Giro 1949, Robert Laffont, 1984).
Quand Chronos et Hannibal
côtoient l’ange de la montagne
Les fabuleux dessins de Pellos (le père des Pieds Nickelés) illustraient, année après année, les drames et les exploits. Chaque mois de juillet réactivait le mythe avec de nouveaux héros, de nouveaux drames et de nouveaux exploits. Pour la période entre 1952 et les années 1970, d’autres lectures (surtout les articles du journaliste Antoine Blondin) m’en avaient raconté l’essentiel. Les années Anquetil (« Chronos » en personne), puis Merckx, « le cannibale » (ou était-ce « Hannibal » ?…). Mais aussi des figures plus légères, « l’ange de la montagne » (le Luxembourgeois Charly Gaul, qui deviendra berger et que le critique Roland Barthes appelait « le Rimbaud du Tour ») et « l’aigle de Tolède » (l’Espagnol Federico Bahamontes). J’étais fasciné par les grimpeurs, ces Samson qui défiaient les Goliath. Les étapes de plaine m’ennuyaient. Pour moi, le Tour de France ne commençait à exister qu’au pied des Alpes ou des Pyrénées. Et je ne rêvais que d’une chose, entendre un jour mes boyaux siffler sur ces routes d’altitude.
De la montagne, je ne sus pendant longtemps que cela. Au-delà du col de l’Iseran commençaient les pentes d’un mont Olympe, demeure des dieux cyclistes et de déesses-montagnes à visage humain. Pellos qui les dessinait ainsi, tantôt bienveillantes, tantôt menaçantes, parfois meurtrières, était le rhapsode du Tour de France. Son « homme au marteau » (la défaillance) et sa « sorcière aux dents vertes » (la malchance) s’abattaient sur les pauvres mortels pédalant. Seuls les héros échappaient à leurs terribles manigances. Il arrivait tout de même qu’on en retrouve au fond d’un précipice, brisés.
Né en Normandie (le pays de « Chronos »), je ne connaissais la montagne qu’à travers cette mythologie de Pieds Nickelés. De la géographie des Alpes, je ne savais que la litanie des grands cols franchis l’été par le Tour de France, au beau milieu de pâturages dominés par des hauteurs insondables. J’en avais aussi une autre vision, hivernale celle-ci, une image horrible et fascinante, entrevue chez des amis de la famille, figurant des hommes ridiculement petits, s’échinant avec échelles, piolets et cordes à franchir des abîmes vertigineux dans le massif du Mont-Blanc.
Coup de buis à Bonnenuit
À mon grand effroi, la famille embarqua un hiver pour L’Alpe-d’Huez où j’appris le ski pour faire plaisir à mes parents. La blancheur de la neige dans ces espaces démesurés me déboussolait littéralement. Ce n’est que bien plus tard, un été, que je compris la seule vocation admissible de ces espaces démesurés : accueillir les troupeaux de vaches et de moutons et, le temps de quelques jours, le peloton et la caravane du Tour.
Parfois, en voiture, nous allions jusqu’au pied du col du Galibier (Hautes-Alpes), toujours fermé, nous recueillir devant le monument Henri-Desgrange, le fondateur du Tour. Le Lautaret me paraissait un aimable hors-d’œuvre, à peine un col. En 1977, nous étions à L’Alpe-d’Huez ; Le « cannibale » faisait son dernier tour. En 1978, nous y étions encore, cette fois pour le premier tour du « blaireau » (Bernard Hinault).
En 1994, j’étais, avec mon vélo, au départ de la Marmotte, une course cyclosportive qui rallie Bourg-d’Oisans à L’Alpe-d’Huez, cent soixante-quatorze kilomètres par les enfers : cols du Glandon, du Télégraphe et du Galibier, montée de L’Alpe-d’Huez. Dans la peau de mes héros ; ou presque. Au sommet du Télégraphe, je donnais déjà des signaux de fatigue, l’homme au marteau m’attendait juste après le hameau (bien nommé) de Bonnenuit sur la route du Galibier. Un coup de buis magistral. Assis sur une borne, je m’endormis. Il n’est pas aisé de se hisser en haut des cols avec toute une mythologie en viatique.
Aujourd’hui, les héros sont morts, ou peu s’en faut, et « Hannibal » est à la retraite depuis longtemps. Les nouveaux héros relèvent plus des biotechnologies que de la mythologie, les cols se grimpent à des vitesses subsoniques, la plupart du temps sur d’excellents macadams. Je ne pense plus à me frotter aux cols alpins autrement qu’à pied ou en voiture. Et désormais, je m’intéresse davantage aux pâturages et aux sentiers.
Retour de bâton et Tour sur bâton
Le temps passant, je pensais en être quitte avec les Alpes et le vélo. Ma croyance s’était un peu émoussée, sans aller malgré tout jusqu’à la crise de foi (je rêve toujours d’aller franchir, un jour, à vélo, le col muletier du Parpaillon qui relie la vallée de l’Ubaye à celle de la Durance). Mais il y a parfois de drôles de hasards et des retours de bâton… Voilà quelques années, alors que je travaillais sur le pastoralisme transhumant entre Provence et Alpes, j’ai entendu parler du berger Michel Carnino, un artiste du couteau, qui taillait et décorait de fabuleux bâtons. J’en ai vu quelques exemplaires, conservés pieusement par ceux qui les avaient achetés ou reçus en cadeaux. On me parlait aussi d’un bâton où il aurait figuré le Tour de France. J’ai fini par savoir qu’il était exposé dans la galerie culturelle du Musée national des Arts et Traditions populaires à Paris. N’y suis-je allé que pour le voir ? C’est bien possible !
Carnino l’a gravé à la fin de l’année 1952, alors qu’il hivernait dans la plaine de la Crau, au domaine des Molières, à Miramas (Bouches-du-Rhône). Un serpent s’enroule classiquement de la base jusqu’au sommet du bâton où, en lieu et place de la scène de transhumance que l’on s’attend à y voir, on trouve une ribambelle de cyclistes en peloton et, tout en haut, au col de Montgenèvre, le maillot jaune de Fausto Coppi qui allait remporter l’étape à Sestrières, côté italien.
Rien ne manque dans ce paysage : la montagne, le poste de douane, les spectateurs, les véhicules de la caravane publicitaire, les motos, les voitures suiveuses et notamment celle de la presse filmée (le Tour 1952 fut le premier couvert par la télévision). Souvenir d’estive, malgré tout, puisqu’en 1952, le Tour de France passait au pied de la montagne où Carnino gardait son troupeau en écoutant le reportage à la radio, comme tant d’autres bergers.
Guillaume Lebaudy, ethnologue, assistant de conservation au musée des Arts et Traditions populaires de moyenne Provence.

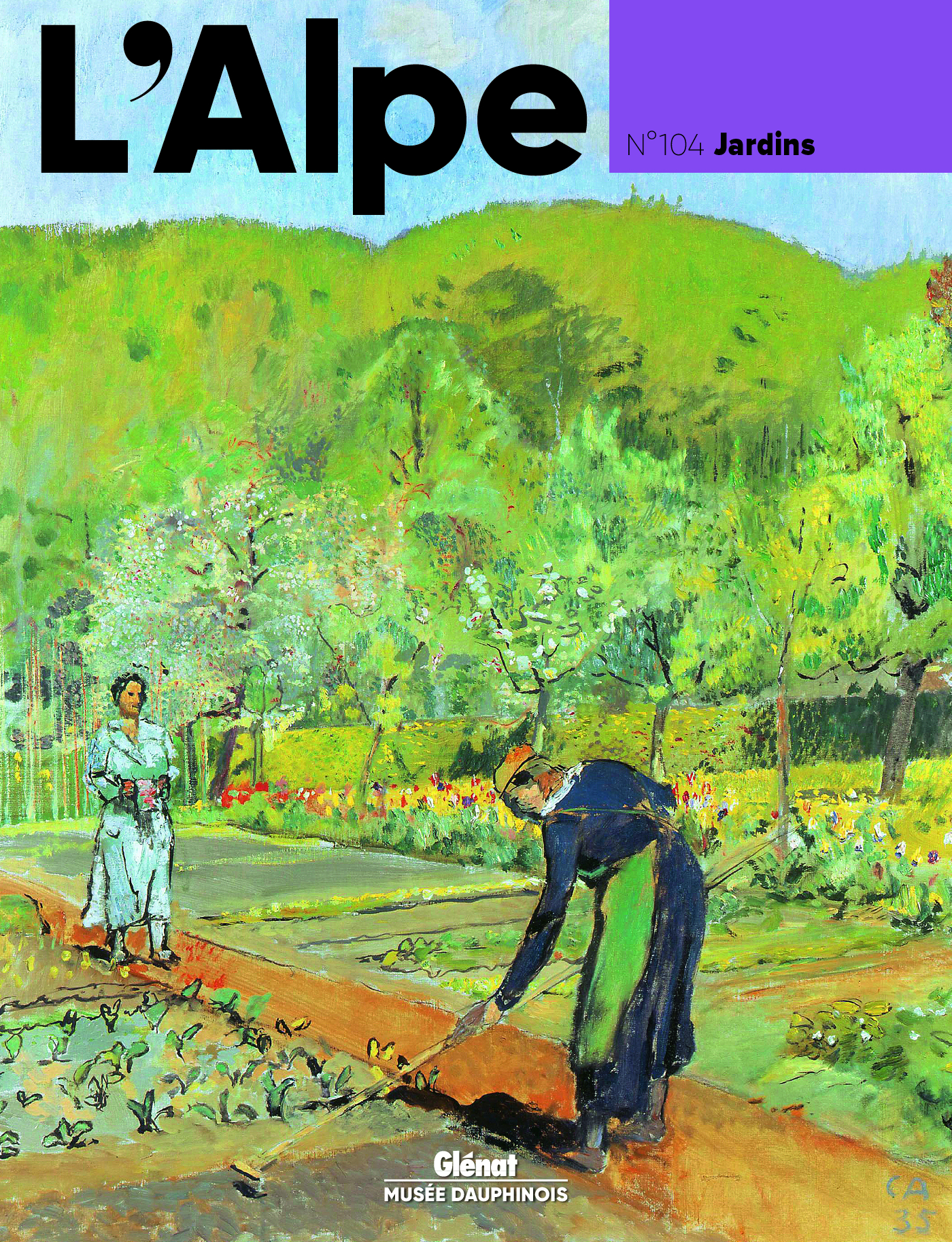

Belle évocation et beaux souvenirs, Je me retrouve bien dans cette phrase : « La blancheur de la neige dans ces espaces démesurés me déboussolait littéralement. Ce n’est que bien plus tard, un été, que je compris la seule vocation admissible de ces espaces démesurés : accueillir les troupeaux de vaches et de moutons et, le temps de quelques jours, le peloton et la caravane du Tour. » Les héros dont tu parles sont des légendes, j’y ajouterais Henry Anglade, si valeureux deuxième du Tour en 1959, et dans la série des drames dont on ne se console jamais, la triste chute de Roger Rivière l’année suivante. mais j’avoue que, contrairement à toi, je garde de l’admiration aussi pour les coureurs d’aujourd’hui qui, certes, expérimentent les biotechnologies, mais font preuve quand même d’un art et d’un courage égaux à ceux des anciens : Romain Bardet, Thibeau Pinot, Alaphilippe… Quand je pense que le jeune van der Pool est le petit-fils de Poulidor…